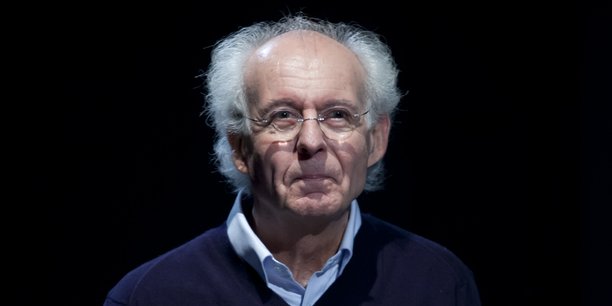
LA TRIBUNE - Comment qualifier ce moment de l'histoire que nous vivons depuis le 9 juin à 21h05 ? Anecdotique ? Unique ? Tragique ? Salvateur ?
ROGER-POL DROIT - Tous ces adjectifs conviennent, et bien d'autres encore. Toute la difficulté est de comprendre pourquoi et comment ils peuvent coexister. La principale singularité de cette tourmente est d'exacerber une série de tensions et de contradictions qui préexistaient, mais leur intensification se révèle si brutale et soudaine qu'on peut avoir l'impression d'y trouver tout et son contraire. Effectivement, la situation est ancienne : les éléments qui s'y retrouvent ne sont pas apparus ce soir-là. Depuis de nombreuses années la gauche se délite et finalement se déshonore, l'emprise de l'extrême droite s'accroit, la droite républicaine se divise, et le centre tangue. Pourtant, la situation est inédite : jamais on n'avait vu un Président français en exercice décider seul, en quelques minutes, de lancer le pays dans une aventure à ce point imprévisible et traumatisante. Aventure tragique, parce qu'elle se présente comme une lutte à mort entre des camps qui ne peuvent ni s'écouter ni envisager de compromis, parce qu'elle réactive le vieux démon de la France attisant affrontements violents et fantasmes de guerre civile. De 1789 à Mai 68, en passant par 1830, 1848, 1871, 1934 et 1936 et Vichy, le peuple français se clive et poursuit un périple où les mots de la haine finissent par tuer. Malgré tout, l'aventure est comique, comme le sont le plus souvent les tragédies humaines, dès qu'on les regarde autrement. Retournements de vestes, trahisons et ralliements, alliances obscènes et discours affolants donnent de la politique, au fil des jours, une image rocambolesque, grotesque. Le spectacle ridicule, magnifiquement joué de toutes parts, de l'ignorance crasse et de la suffisance perverse donnerait envie de hurler de rire si les perspectives n'étaient sérieuses et périlleuses. Le paradoxe central de cette situation me paraît tenir en deux mots : elle est à la fois catastrophique et clarificatrice. Le choc qu'elle a provoqué a plongé une grande partie des citoyens dans une angoisse intense, en les confrontant à une sorte d'apocalypse imaginaire. En accélérant de façon apparemment incontrôlée un choix rapide entre des mouvements radicaux, cette dissolution et ces élections ont mis les citoyens face à leurs exaspérations autant que face à leurs responsabilités. L'inquiétude de la fatalité le dispute à la prise de conscience de la liberté. Ce qui se clarifie à mesure, c'est donc la réalité française d'aujourd'hui, et à terme celle de l'Europe.
Comment la philosophie s'empare-t-elle d'une actualité aussi indicible ? Sur quels registres peut-elle apporter une lecture saillante ?
Le regard du philosophe n'est pas celui du politologue ni du sociologue. Plus distancié, il est animé avant tout par le désir de comprendre plutôt que de juger. Je viens d'évoquer ce qui fait pleurer et ce qui fait rire dans l'étrange chaos que nous traversons. Mais, s'il existe un registre spécifique de l'attitude philosophique, il ne se situe ni dans la critique acerbe ni dans la dérision. Comme l'écrivait Spinoza à Oldenburg : « Pour moi, cependant, ces troubles ne m'incitent ni à rire ni même à pleurer, mais plutôt à philosopher, et à mieux observer la nature humaine ».
Philosophons, donc, et auscultons cette « nature humaine ». Vivons-nous un cas d'école de « philosophie politique » ?
Est-il possible d'adopter pareil « regard éloigné » dans la situation que nous vivons ? Cela me paraît improbable, parce qu'elle suscite les passions plutôt que l'analyse. Ce qui, en fin de compte, peut constituer une leçon inattendue de philosophie politique. Car on avait trop tendance à penser le politique sous l'angle de la rationalité, des calculs stratégiques et des accommodements raisonnables. En oubliant les tripes, les colères, les rancœurs et les humeurs. Le pouvoir et l'histoire sont aussi faits de bruit et de fureur, de passions destructrices et de pulsion de mort. C'est d'ailleurs ce que Platon, finalement, reprochait à la démocratie.
Platon, mais aussi Périclès, Aristote ou Socrate : que penseraient-ils de la France de juin 2024 ?
Rappelons que philosophie et démocratie sont originairement antagonistes et non, comme on le croit souvent, sœurs jumelles. C'est contre la fluctuation des opinions, l'irascibilité du peuple, l'irrationalité des humeurs démocratiques et l'aveuglement des citoyens que la philosophie politique de Platon s'est constituée, en critique de ce mauvais régime. On ne saurait oublier que Socrate, modèle du juste, est condamné à mort très légalement par l'assemblée du peuple d'Athènes. Que la démocratie permette pareil crime suffit à la condamner, aux yeux de Platon. Il écrit La République, qui est en fait une Cité idéale totalitaire, pour concevoir un régime guidé par le savoir, capable d'échapper à ce règne des émotions. Toutefois, on peut se demander si c'est bien en démocratie que nous vivons, ou bien dans ce que l'historien Polybe nommait « ochlocratie », non pas la domination du peuple (démos) mais celle de la foule (ochlos) où règne humeurs, rumeurs et caprices.
De quels poisons « inédits » notre démocratie souffre-t-elle singulièrement ?
Ce qu'on observe le plus nettement aujourd'hui, c'est l'extension et le durcissement de la haine. Vivre avec les autres, condition primordiale de toute société, semble devenir de plus en plus difficile. Les forces de désagrégation, de fracture et de morcellement l'emportent sur celles d'union, de cohésion de rassemblement. Dans les termes de la mythologie freudienne, Thanatos l'emporte sur Éros. La société se désassemble. Chacun fait bloc avec ceux qui lui ressemblent et rêve d'en finir avec ceux qu'il déteste parce qu'ils ne sont pas comme lui. Il y a bien longtemps que le débat politique, même rude, a disparu au profit de la détestation personnelle. Peu importe ce que tu dis. Qui tu es suffit à te condamner. Ce qui s'estompe sous nos yeux, c'est en fin de compte le souci du bien commun, de la « chose publique » qui n'appartient à personne parce qu'elle appartient à tous. L'horizon du collectif s'estompe en fonction de l'exacerbation non seulement d'un individualisme forcené mais aussi de la « rancune de tous contre tous », pour reprendre l'excellent diagnostic de Jean-Claude Milner. Le ressentiment devient la chose du monde la mieux partagée.
« Irrationnelle », « folle », « inconcevable », ces adjectifs reviennent fréquemment pour qualifier la décision du chef de l'État. A-t-il trahi son devoir de responsabilité, et même ce que doit être l'éthique de la responsabilité d'un Président ?
Cette dissolution, parfaitement légale et conforme aux règles de la Constitution, n'en est pas moins incompréhensible du point de vue de la rationalité politique. Décision brusque, solitaire, elle ne semble correspondre à aucun calcul politique cohérent. Je ne crois pas que l'éthique, sous quelque forme que ce soit, soit ici une question pertinente, car elle ne concerne la politique que de biais. Un président n'a pas de devoir de ce type, il n'a de comptes à rendre qu'à la loi.
Vraiment ? Être aux commandes « responsables » d'une démocratie ne dicte-t-il pas de rendre des comptes tout autant au peuple ? C'est peut-être d'ailleurs d'avoir négligé ce devoir qu'il est désormais puni.
Plus précisément, il a pour obligation de préserver le bien commun et l'unité de la nation, en tenant compte de la situation intérieure comme de la situation internationale. Or c'est là que cette décision ne semble correspondre à aucune logique, mais plutôt à une impulsion destructrice, voire suicidaire. Car les répercussions prévisibles de ce coup de théâtre sur les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron sont impressionnantes, et toutes négatives. L'empire russe s'acharne sur l'Ukraine, et le président français a pris des positions courageuses pour soutenir cette démocratie. Dans une Europe divisée et affaiblie, il commençait à construire son leadership. Le chaos désormais enclenché sape son autorité, ruine son champ d'action, fragilise l'Europe et la paix mondiale, au pire moment. Rien de ceci n'étant rationnellement compréhensible, la seule explication qui me paraisse plausible est d'ordre psychologique. Il se pourrait que les résultats des élections européennes, piteux pour la macronie, aient entraîné une décompensation chez un homme fatigué, se sentant dans l'impasse, ne supportant plus d'être détesté et désavoué durablement par un nombre croissant de citoyens.
Sa décision et ses conséquences annoncent-elles nécessairement un affaiblissement supplémentaire de la démocratie ? Ou au contraire, comme il le défend, a-t-il voulu responsabiliser les citoyens au profit de la démocratie ? Quand un parti aux ressorts non démocratiques accède au pouvoir par les urnes, est-ce tout de même une victoire de la démocratie ou seulement un effondrement du politique ? Difficile de trancher. Notre démocratie est-elle assez robuste pour traverser cette tourmente imprévue ?
Je le crois. Au cours de sa très longue histoire, elle a surmonté quantité d'épreuves en conservant ce qui est sans doute son axe central : l'égalité de parole et de décision. La démocratie antique, dont Athènes incarne le modèle, est fondée sur une parole directe, dans les assemblées et les tribunaux, mais restreinte aux hommes libres. Le démos ne recouvre qu'une petite partie de la population, femmes et esclaves en sont exclus. Après de longs siècles de monarchies et d'empires, quand la Révolution française commence à réactiver le rêve démocratique, c'est sous la forme, progressivement réalisée, du suffrage universel et de la délégation parlementaire. Les révolutions et les guerres des deux derniers siècles ont façonné le cadre théorique et pratique de cette démocratie. Il se trouve confronté aujourd'hui à de multiples défis qui imposent de le refaçonner sans le défigurer.
D'un point de vue philosophique, extrême gauche et extrême droite « à la française » sont-elles d'égale « valeur » lorsqu'il s'agit de mesurer leurs considérations des libertés, des égalités, de la démocratie ?
Le vrai drame, à mes yeux, est que l'on en soit arrivé à poser la question dans ces termes : qui est le plus dangereux ? Au lieu de se demander qui est préférable et pourquoi, on s'interroge uniquement pour savoir qui est le pire. Cette logique de la crainte et du barrage est une inversion complète de la démarche politique ancienne. Cette dernière cherchait d'abord l'horizon à construire et les progrès à réaliser. Les citoyens avaient à discerner, dans les idées et les personnes, où placer leur confiance. Aujourd'hui, ils cherchent avant tout à savoir de qui se méfier. Le vote devient donc une action négative. Barrage plutôt qu'adhésion, rejet plutôt que soutien, panique plutôt qu'espoir. C'est le triomphe des « passions tristes » : peur, animosité, mépris, défiance...
... haine, exclusion, nostalgie. Comment ces « passions tristes » prennent-elles forme ?
Le signe majeur de cette destructivité est l'antisémitisme des uns et des autres. Personne ne peut nier son explosion ni sa place centrale. Il faut d'abord rappeler combien la haine des juifs ne concerne pas simplement une « communauté », mais tous les citoyens d'une société démocratique. Il est obscène de juger, comme on l'entend sans cesse, que l'antisémitisme concerne la « communauté juive », elle seule, et pas chaque citoyen. Parce que l'éthique et la démocratie, de quelque manière qu'on les définisse et les conçoive, n'ont d'existence qu'en relation avec un horizon insuppressible d'égalité et d'universalité. Cet horizon, par définition, inclut les juifs et tous les autres. Il présuppose que l'offense faite à quiconque indigne potentiellement chacun, quel qu'il soit. Il invalide donc radicalement, d'entrée de jeu, la simple possibilité qu'une forme quelconque de persécution mobilise exclusivement celles et ceux qui la subissent. Toute offense est faite à tous, et soulève l'indignation de chacun.
Cette universalité de principe n'est-elle pas utopique ?
Je ne le pense pas. Qui donc soutiendrait que des droits refusés aux Noirs ne révoltent que les Noirs ? Que le racisme n'est intolérable qu'à celles et ceux qu'il vient frapper ? Qu'une persécution - pour quelque prétexte religieux, ethnique, culturel ou politique que ce soit - ne suscite la colère et les luttes que de ceux qu'elle accable ? Qui accepterait l'idée que des offenses faites aux femmes ne concernent pas les hommes, ou que la haine des homosexuels laisse indifférents les hétérosexuels ? Aucun rejet, aucune stigmatisation ne concerne jamais seulement ceux qui en sont frappés, mais tout le monde, sans exception possible, sans reste concevable. Voilà pourquoi la liberté et l'égalité accordées ou refusées aux juifs constitue, depuis des siècles, un indice fiable de l'état global d'une société politique comme d'une morale publique. Or, depuis le 7 octobre 2023, une haine antijuive intense s'est développée, inversant tous les signes, faisant des juifs de prétendus nazis, transformant les victimes de la barbarie terroriste en bourreaux, déniant au peuple juif le droit d'avoir un État, le droit de le défendre, le droit d'en assurer la sécurité contre ceux qui ont pour objectif de l'effacer de la surface de la terre. Il existe d'innombrables formes de l'antisémitisme. On peut se livrer à d'ingénieuses contorsions pour les distinguer, les hiérarchiser ou les nuancer. Cela me paraît absolument vain. Au bout du compte, les victimes de cette haine sont toujours les mêmes.
Les formes d'antisémitisme qui s'expriment sur l'échiquier politique ont-elles les mêmes racines et poursuivent-elles un objectif commun ?
Force est de constater que l'antisémitisme est aujourd'hui attisé à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Il est développé et défendu au sein de LFI, porté en étendard par certains de ses députés et son leader. Ce qui n'est pas le cas du côté de l'extrême droite. Je n'ignore pas d'où vient le Rassemblement national, la présence de nostalgiques de Vichy parmi ses fondateurs, ni l'antisémitisme virulent de Jean-Marie Le Pen, ni celui de nombre de militants actuels. Toutefois je constate, comme tout le monde peut le faire, que les discours explicites de ses dirigeants actuels, leurs positions officielles et répétées, ne vont pas dans le sens d'une persécution des juifs. Je conçois fort bien qu'on leur prête toutes sortes d'intentions cachées, de vrais visages dissimulés sous des masques respectables. Mais il me semble que la politique est faite de mots et d'engagements avant tout. Or les mots et les engagements de LFI et de Jean-Luc Mélenchon ne font, sur ce point, aucun doute. Son soutien répété au Hamas constitue un engagement antisémite affiché, assumé, hautement revendiqué. Je n'ignore pas les finasseries pitoyables que les militants s'efforcent de développer : l'antisionisme ne serait pas un antisémitisme, le soutien à la « résistance » du Hamas serait purement politique... Faut-il rappeler que le Hamas refuse radicalement l'existence de deux États ? Qu'il n'a pour objectif que la destruction totale de l'État d'Israël ? Soutenir ce mouvement islamiste fanatique, aussi barbare et inhumain que Daech, aussi peu démocrate qu'Al-Qaïda, en faire un mouvement héroïque, proclamer que les militants occupant Science Po Paris en soutien à cette dictature sanglante sauvent « l'honneur de la France », ce n'est pas simplement une faute politique impardonnable, parmi tant d'autres. C'est une ignominie absolue. Jamais je n'aurai pensé être un jour confronté, au pays des droits de l'homme, à pareil déferlement d'insanités meurtrières. Certes, il ne faut pas oublier la vieille obsession antisémite de la gauche, depuis Proudhon jusqu'aux caricatures de l'Humanité des années 1930, que les travaux de l'historien Michel Dreyfus ont mis en lumière depuis une trentaine d'années. Cette tradition qu'on ne veut pas voir s'était assoupie après la Shoah.
Lors du second tour le 7 juillet, si l'alternative se présente dans votre circonscription, comment allez-vous arbitrer entre un candidat LFI et son adversaire RN ?
La folie de la situation présente est finalement qu'on se trouve confronté au choix entre l'antisémitisme présent, explicite, bruyant et virulent palpable chez LFI, et l'antisémitisme ancien du RN, feutré, pétainiste, catholique et collabo, dont on soupçonne la survivance et l'éventuelle résurgence. Pour ma part, s'il faut choisir entre peste et choléra, il est exclu de voter pour LFI et donc pour tous ceux qui ont fait alliance avec le soutien au terrorisme antisémite financé par le Qatar et manipulé par l'Iran. J'ai assez lutté contre l'extrême droite dans mes vies antérieures, contre la propagation de ses idées et contre leur nuisance, pour ne jamais voter pour ce camp, quelle que soit son évolution supposée. Mais je comprends que Serge Klarsfeld s'y résolve, même si pour ma part je m'y refuse.
L'ADN de l'extrême droite consacre à la « connaissance », synonyme d'émancipation, d'accomplissement de soi et de liberté, une grande méfiance. Faut-il redouter une vague obscurantiste ?
Peut-être suis-je mal informé, mais je n'ai pas le sentiment qu'un obscurantisme menace de ce côté. En tout cas, si un nouvel obscurantisme est déjà bien présent, c'est celui de la pensée woke, qui est en passe de disqualifier tout connaissance objective, de saper les fondements de la rationalité scientifique, et d'instaurer, au nom d'une émancipation sens dessus dessous, censure, exclusion et terreur intellectuelle, comme l'a montré notamment le philosophe Jean-François Braunstein dans La religion woke.
Où sont les intellectuels ? Ils sont absents du sérail médiatique. Soit parce qu'ils refusent de prendre la parole, soit parce qu'on ne leur propose plus. Ont-ils renié leur raison d'être ? Ou leur absence résulte-t-elle de leur décrochage des réalités du pays qu'ils ne comprennent pas ?
Je ne partage pas votre impression. Il me semble au contraire que l'on entend beaucoup les intellectuels. Ils se mobilisent, pétitionnent et pérorent as usual, si j'ose dire. Qu'on ne les écoute plus, ou qu'ils n'aient plus grand chose d'intéressant à exprimer, est une autre affaire. Il est vrai qu'entre les extases de Drieu la Rochelle face au régime nazi, de Gide face au régime stalinien, de Sartre envers Castro et Mao, de Foucault envers l'Iran, et d'innombrables égarements de la même eau, la confiance envers la lucidité des intellectuels vaut d'être tempérée...
Vous avez été chercheur. De quelle marge de manœuvre dans leur liberté d'expression, chercheurs et universitaires disposent-ils, eux qui sont soumis à la règle « scientifique » des faits ?
J'ai effectivement travaillé plus de vingt-cinq ans au CNRS. Dans ces recherches, dans les « sciences dures » aussi bien que dans les sciences humaines, une exigence de rigueur est de mise. Elle est parfaitement distincte, à mes yeux, de ce chacun peut et doit exprimer en tant que citoyen, en faisant un « usage public de sa raison », comme disait Kant, en dehors de l'institution, du laboratoire et de ses travaux. En tant que fonctionnaire, on est soumis à une obligation de réserve. En tant que chercheur, à une obligation du respect des règles scientifiques. Rien n'empêche de dire ou d'écrire ce qu'on veut ailleurs, à titre personnel. Ce qui est fâcheux, c'est le mélange des genres, dont il existe plusieurs versions : la recherche militante, le cautionnement de convictions arbitraires par des validations académiques, le transfert de notoriété d'un domaine de compétence circonscrit vers des questions qui échappent à ce domaine.
« Quelque chose » de positif peut-il sortir plus tard d'un événement dont nous ignorons encore tout des formes qu'il prendra au lendemain du 7 juillet ?
Le verdict des urnes, quel qu'il soit, est bien plus intéressant que n'importe quelle élucubration. Au jour où nous nous parlons, 25 juin 2024, le premier tour n'a pas eu lieu. Personne ne peut dire quelle sera l'issue finale de ce scrutin. Même s'il devait déboucher sur une confiscation de la démocratie par un extrême ou par l'autre, ce résultat lamentable n'en serait pas moins, en un sens, « positif ». Car mieux vaut savoir où l'on en est, même si c'est une catastrophe, que de vivre dans l'imaginaire et l'illusion. Comme à cet instant rien n'est joué, il est toujours possible de répéter que l'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais ce ne sont là que piètres consolations. Parce que ce qui s'est mis en route avec cette dissolution vient de plus loin et va se poursuivre fort longtemps, et de manière imprévisible, sauf pour dire que le chaos ne fait que commencer. Le plus probable, au moment où nous nous parlons, est que la France se révèle ingouvernable pour cause de tripartition : deux camps extrêmes de poids à peu près équivalent mais probablement dépourvus de majorité absolue, et un centre en perte de vitesse. Ce blocage des institutions laisse présager une cascade de péripéties dont les répercussions économiques, sociales et psychologiques pourraient être immenses.

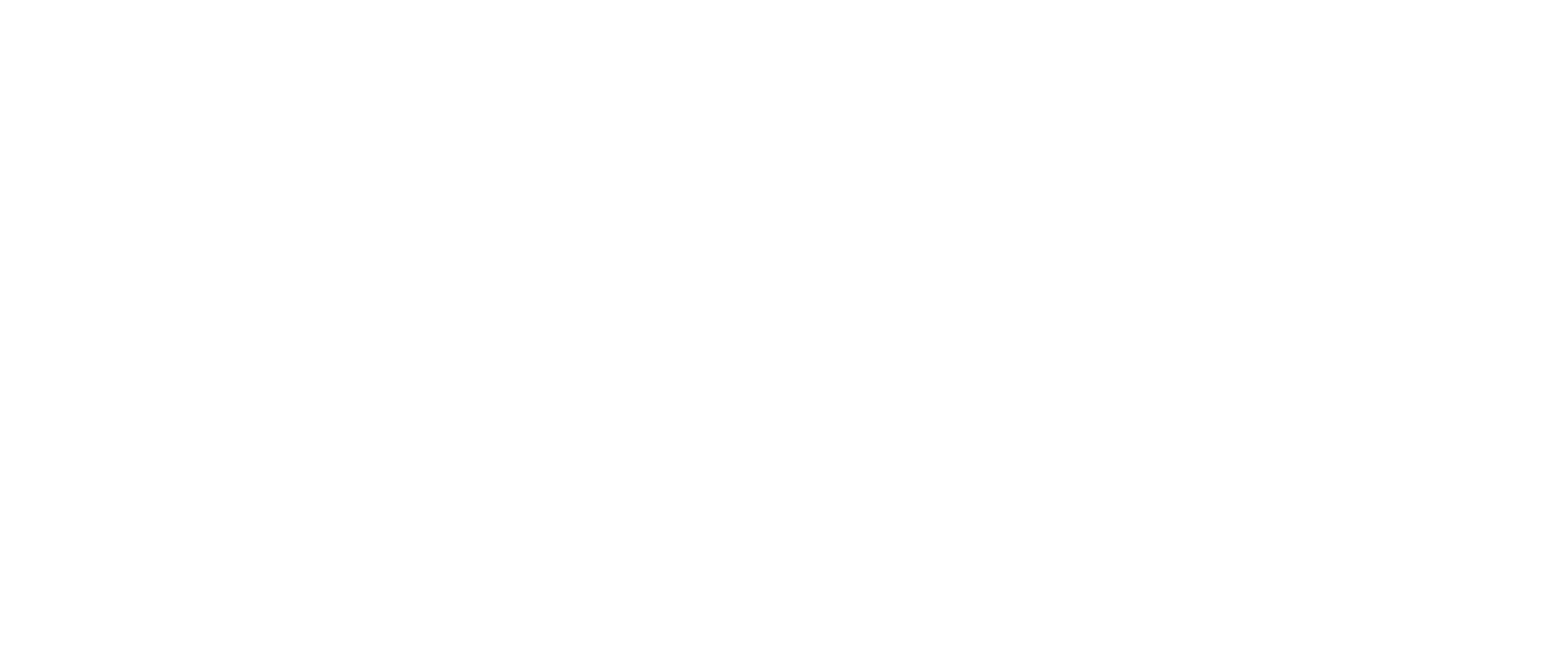
 Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français
Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

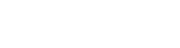
Sujets les + commentés