
LA TRIBUNE - Par quel mot l'économiste - et présidente du Cercle des économistes - synthétise-t-elle ce que lui inspire ce post-9 juin ?
FRANCOISE BENHAMOU - La tétanie. Je suis figée, sidérée. A la fois par l'extrême brutalité de l'annonce, à laquelle (quasiment) personne n'était préparé. Par ses conséquences sur notre démocratie. Et aussi par l'ampleur des questions et même des menaces que la campagne électorale, qui met en jeu une surenchère de promesses irréalistes, fait peser sur la société et sur l'économie françaises. Car cette annonce s'est télescopée avec celle d'un niveau de dette publique qui semble un peu plus encore infranchissable. A ce titre, le programme du Nouveau Front populaire est extraordinairement coûteux, et risque de s'avérer incohérent avec l'enjeu, fondamental, de maîtriser de nouveau la dette publique et de préserver l'emploi. Financé par une très forte hausse des impôts, il est dédié à revaloriser substantiellement les revenus modestes. Noble vœu, mais qui signifie un enchérissement du coût du travail difficilement compatible avec l'état des finances de nombre de TPE/PME. Du côté du Rassemblement national, les recettes nouvelles propres à financer les annonces - reconsidérées chaque jour - sont illisibles et devront nécessairement puiser dans une diminution drastique des dépenses publiques. Penser que la chasse aux fraudeurs remettra à flot les caisses de l'Etat est une totale ineptie. D'ailleurs qu'en savent-ils ? Au moment où nous échangeons, les députés RN interrogés avancent un effet une « chasse aux fraudes fiscales et sociales » qui s'étage sur une échelle de 10 à... 50 milliards d'euros ! Rien n'est chiffré ni sérieusement argumenté. Et c'est peut-être le plus inquiétant. En fait, le fil rouge (si je puis dire !) du programme se situe dans la préférence nationale.
Les reculs permanents du RN sur ses engagements poursuivent-ils le vœu de « rassurer » un électorat de dirigeants d'entreprise que l'on sait potentiellement plus sensible aux thèses du RN qu'à celles du NFP, ces dernières bien plus confiscatoires de leurs revenus et de leur patrimoine ?
D'ici aux « Rencontres d'Aix » - 5-6 juillet, elles réunissent le « gratin » de l'écosystème économique et entrepreneurial, autour d'économistes académiques et d'experts NDLR - au cours desquelles j'échangerai avec un grand nombre d'entre eux, il m'est difficile d'apporter une réponse. A ce stade, si l'on peut détecter chez certains une sensibilité pour le programme du RN, on peut y voir d'une part une forme d'aversion à l'impôt, d'autre part l'idée que l'intérêt de l'entreprise serait mieux préservé en évitant une hausse trop brutale du SMIC. Il s'agit là d'une vision à court terme. Car les dégâts macro-économiques inhérents au programme RN n'épargneront aucune entreprise. Sachant que prévaut une inconnue : tout acteur économique est aussi une femme ou un homme, et son arbitrage électoral peut privilégier sa conscience sur son intérêt. J'ajoute que le monde économique déteste l'incertitude. Or quelles que soient les hypothèses les plus vraisemblables qui émaneront des urnes le 7 juillet, toutes ou presque convergent vers ce que ce monde économique redoute peut-être le plus : l'ingouvernabilité, synonyme d'impasse, et l'absence de prévisibilité.
Impasse institutionnelle, politique, économique et avant tout démocratique...
Ce sentiment d'être coincé en effet au fond d'une impasse « plurielle » semble traverser l'esprit des Français, conscients que le moment est d'une grande gravité, et que le pays se trouve fragilisé. Certes, l'incertitude, les chefs d'entreprise y sont habitués, par exemple en matière d'innovation. Elle fait partie de leur « réalité », comme lorsque surviennent des événements imprévisibles - crise des subprimes, pandémie Covid-19, guerre en Ukraine.... Mais en l'occurrence, l'incertitude est d'une autre nature. A l'inquiétude s'ajoutent l'incompréhension voire la colère provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale : pourquoi créer ex nihilo un trouble, une précarité, une angoisse ? Pourquoi fragiliser de l'intérieur le monde social et économique quand les facteurs extérieurs d'instabilité sont déjà si aigus ? Et au-delà, pourquoi mettre à bas un système politique, fût-il sacrément abimé, et mettre en danger une société déjà déboussolée ?
A propos d'innovation, substantifique moelle des entreprises, que sait-on de l'attention que les formations extrémistes lui confèrent : centrale ? anecdotique ? hostile ?
L'innovation est une notion qu'on a pu associer au « macronisme ». C'est bien sûr une erreur. Le chef de l'Etat a incarné avec détermination la génération « innovation », avec pour point d'orgue la « start up nation », et d'importants dispositifs fiscaux ou de financements publics (France 2050 notamment) au profit des entreprises innovantes. Objectivement, comment s'en plaindre ? Faut-il rappeler que l'innovation est cardinale pour faire vivre, développer, voire sauver les entreprises ? Or la cristallisation politique sur la personne du Président crée l'amalgame sur tout ce qu'il a entrepris. L'innovation n'y échappe pas. C'est bien regrettable. Elle est invisible dans les programmes des candidats, sans qu'il soit vraiment possible d'interpréter le sens de cette absence. Simple « oubli » lié à la précipitation du calendrier programmatique ? Amateurisme ? Méfiance ?
Les organisations patronales ont consacré leur examen des programmes économiques et ont circonscrit leur rejet des copies RN et NFP aux aspects factuels. Elles se sont gardées d'aborder le terrain philosophique et moral, reflétant en ce sens l'attitude de l'immense majorité des chefs d'entreprise. C'est compréhensible - que « dire » lorsque potentiellement la moitié de ses adhérents, salariés, clients, actionnaires portera son suffrage vers l'extrême droite ou LFI ? -. Mais n'est-ce pas aussi malheureux ? Surtout que depuis quelques années, le périmètre de responsabilité des entreprises dicté par la société civile, stimulé par la loi et revendiqué - parfois avec force arguments marketing - par les directions, s'est considérablement étendu.
Je partage votre sensibilité. Exercer une responsabilité de dirigeant (d'entreprise, de syndicat patronal ou salarié) signifie avant tout « faire (bien) tourner » l'organisation qu'on s'est vu confier, avec une vision sous-jacente du contexte économique et social dans lequel elle s'inscrit et des objectifs que l'on entend poursuivre. En 2024, cette responsabilité n'a presque plus de frontières. Le comportement que la RSE (responsabilité sociale, sociétale et environnementale) stimule et auquel même elle « oblige » a bouleversé ce qui est « réclamé » des entreprises. Engagement face à la situation climatique, pressions des consommateurs, attentes des salariés, exigences des autres parties prenantes, et des dispositifs comme la loi Pacte commandent aux entreprises une attention nouvelle aux « valeurs » qu'elles véhiculent ; on évoque même - et de longue date - la notion d'entreprise à mission.
Notion extrêmement sensible, tant son sens est galvaudé et instrumentalisé. Elle doit être maniée avec beaucoup de précaution, la première étant de faire preuve de prudence, de retenue, d'humilité, au risque sinon de s'exposer à un « désalignement » délétère...
Effectivement. Par exemple, lorsqu'on « est » entreprise à mission, peut-on s'exonérer d'émettre une opinion sur une perspective politique contraire à sa... mission ? Lorsqu'on promeut des principes de concorde, de diversité, de respect, peut-on se taire face au spectre de l'extrême droite ? Je m'interdis de donner le moindre conseil et encore moins de juger ; en revanche je m'autorise à exercer ma liberté de conscience et d'expression. Et celle-ci m'invite à encourager les dirigeants d'entreprise à manifester leur rejet des idéologies contraires à ce qu'ils entendent incarner dans la société.
Dans l'hypothèse où le RN obtiendrait une majorité absolue et conduirait un gouvernement, les corps de la haute fonction publique sont tiraillés ; doivent-ils accomplir « normalement » leur mission ? démissionner ? agir avec déloyauté pour respecter leurs « valeurs » ? ou résister de l'intérieur ? Des cas de conscience qui concernent toute la sphère professionnelle. S'appliqueraient-ils aux entreprises ?
Concernant la haute fonction publique, tout dépend de ce qui serait demandé - exigé -, et de la conscience de chacun. Du côté de l'entreprise, je ne crois pas. Une chose est, pour un dirigeant, d'avoir une parole publique. Mais l'entreprise n'a pas pour objet d'être un lieu ou un acteur de résistance (... ou de collaboration). Sauf bien sûr en économie de guerre ou dans un contexte ouvertement totalitaire - or nous n'en sommes pas là, et la France de 2024 ne reproduit pas celle de 1940. En revanche l'entreprise peut être un espace de discussion, de rencontre, de libération de la parole, d'émancipation, de liens humains et sociaux. L'entreprise est un terrain rêvé pour casser les solitudes, pour hybrider les intelligences, pour mailler les créativités. Cela quel que soit le contexte politique, car cela devrait figurer - en tous cas en théorie - dans son ADN.
Par sa gouvernance, son actionnariat, son management, et quelques innovations, peut-elle même exercer un rôle d'amortisseur, de catalyseur social si la tension politique et le marasme démocratique fragmentent, électrisent voire incendient la société ?
Je suis convaincue qu'en cas de dégradation du contexte social, politique, démocratique, les entreprises peuvent être un recours. Ne versons pas dans un angélisme qui les propulserait au rang de sauveur ; reconnaissons en revanche que nombre d'entre elles essayent de cultiver des règles de respect, de dialogue, de débats, essayent de rechercher une certaine harmonie, essayent de s'apparenter à des micro-sociétés apaisées. Toutes n'y parviennent pas, évidemment. Mais au moins elles essayent. C'est déjà beaucoup. Un exemple est symbolique. En avril, Michelin annonçait pour ses 132 000 salariés l'instauration d'un « salaire décent » assorti d'un « socle de protection sociale universel » pour ceux qui ne relèvent pas de la règlementation française. Cette mesure « choc », élaborée en collaboration avec l'ONG Fare Wage Network, part du principe qu'un salaire décent « doit permettre à une famille de deux adultes et deux enfants de se nourrir, de se loger, de se soigner, d'assurer les études, de constituer une épargne de précaution, d'envisager des loisirs et des vacances ». Résultat, le salaire annuel décent des collaborateurs en France doit s'établir désormais à 25 356 euros (à Clermont-Ferrand, davantage à Paris), soit 20% au-dessus du Smic. N'est-ce pas la démonstration que dans l'entreprise peut naître un contre-feu aux errements extérieurs ?
Les cénacles universitaires, académiques, intellectuels, et même culturels, sont assez silencieux. Certes, la place que la grande majorité des médias traditionnels leur réserve s'est considérablement réduite, mais tout de même... Comment interprétez-vous cet effacement ? Que signifie-t-il de la considération que l'époque leur confère, mais aussi des erreurs qu'eux-mêmes ont commises ?
Coincé dans un agenda de fin d'année post-examens, et « plombé » quelques semaines plus tôt par l'importation dans ses murs du conflit israélo-palestinien, le monde universitaire peut difficilement se mobiliser en tant que tel. Quant au silence de nombre d'intellectuels, il a plusieurs explications. L'une d'elles est centrale : hier, ils avaient une approche assez holistique des situations, leur opinion était transdisciplinaire, sans doute aussi avaient-ils un goût prononcé pour la « chose politique ». Aujourd'hui, ils sont très spécialisés dans leurs domaines respectifs, et sont sollicités davantage en leur qualité d'expert. Cette réalité épouse un mouvement plus profond d'hyperspécialisation et de cloisonnement des pensées. Cela dit, parce que l'échéance se rapproche, parce que les débats se tendent, on les entend de plus en plus.
L'irruption des réseaux sociaux n'est pas neutre. Ainsi des voix disparaissent parce qu'elles ne veulent pas entretenir cette immense lessiveuse ou redoutent d'être les cibles d'une communauté hystérique hostile à leurs propos. D'autres au contraire profitent de ce décorum pour usurper une reconnaissance d'intellectuels ou de pseudo-experts...
Et ce constat soulève une grave interrogation : si l'intellectuel est censé être un « honnête homme/femme », c'est-à-dire une « personne intègre », a-t-il vocation à s'exprimer dans des formats courts, qui caricaturent la pensée ? Cela pose la question des voies empruntées par les intellectuels - et gens de culture - pour exprimer leur colère ou leurs engagements. L'heure des grandes tribunes signées par des « sachants » me semble révolue et même contreproductive. En effet, comment une tribune co-signée par quelques figures médiatiques dans un grand quotidien est-elle accueillie ? En substance, comme la « provocation arrogante de quelques privilégiés reclus dans leurs beaux quartiers parisiens ». Peut-on contester à un Lozérien de se sentir déclassé voire rabaissé par l'image du trentenaire « bobo » ralliant en trottinette le Théâtre de l'Odéon ? Cette réaction n'est - malheureusement - pas totalement dénuée de fondement, et c'est sur cette image caricaturale que s'appuient ceux qui veulent fustiger la politique culturelle, alors même que les études montrent que les oppositions simplistes du type villes vs territoires ruraux, populaire vs élitiste, grandes vs petites institutions, doivent être dépassées. Certes, les élites doivent s'interroger sur leurs responsabilités. A l'instar d'Ariane Mnouchkine : « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Ou fait que nous n'aurions pas dû faire ? ». Question à la fois cruciale et douloureuse. Mais on sait aussi que la culture anti-élite nourrit le populisme et les idées de ceux qui s'en prennent à la liberté de créer. La voie est étroite afin de défendre la création tout en ayant sans cesse le souci de l'accès de tous à la culture.
Parmi vos domaines d'expertise figure justement l'économie de la culture. Ce domaine aussi est peu présent dans les programmes - tout comme Bercy l'a frappé d'un rabotage radical en 2024, ramenant à 1% l'augmentation du budget du ministère de la Culture confirmée à 6% quelques mois plus tôt. La place, invisible, que la culture occupe dans ses priorités, que dit-elle de l'attention que le RN lui réserve ?
Questionner la place de la culture - et de l'audiovisuel public - dans un programme politique, c'est vraiment questionner le sujet des « valeurs ». Celles du respect, de l'écoute - ce qui n'interdit pas la critique -, de la diversité, de l'audace, de la transgression, de l'imagination sont insécables de la créativité artistique. Que trouve-t-on au théâtre ? L'extraordinaire faculté de « transmettre », notamment les moments tragiques, cardinaux, merveilleux d'une grande Histoire de laquelle les jeunes générations semblent parfois éloignées. Or cette déconnexion les rend vulnérables aux messages des « alternatives », nommées réseaux sociaux, que Jordan Bardella et consorts manient avec succès. Une population « écartée » de la Grande Histoire, sans rapport avec ses épisodes tragiques qui pourtant éclairent notre présent, est une proie dans une démocratie aussi « molle » que la nôtre, au sens où elle est indolente, insuffisamment attentive aux conditions de sa survie. Et puis l'action de la France dans le domaine culturel dépasse ses frontières. Par exemple, elle a été au premier rang du combat pour la défense des droits d'auteur, en riposte aux bouleversements liés au numérique et aux pressions des GAFAM. Quand j'observe Giorgia Meloni et son ministre de la culture Gennaro Sangiuliano se donner comme objectifs le développement d'un « nouvel imaginaire italien » et la réhabilitation d'un sentiment national, quand je vois Victor Orbán organiser l'éviction des formes d'expression artistique « non conformes à l'identité et aux valeurs nationales », je suis particulièrement inquiète.
L'un des vœux que le RN a clairement affichés et sur lesquels il n'a pas tergiversé depuis le lancement de la campagne est la privatisation du service public de l'audiovisuel - la dissolution enterre de facto la « réforme Dati » qui promettait la fusion des établissements publics de l'audiovisuel. Comment qualifiez-vous son exaucement ?
Cette privatisation serait une catastrophe.
Entrons dans les détails économiques, financiers, idéologiques, et même philosophiques...
Ce projet intervient au moment où le financement de l'audiovisuel est otage d'un grave hiatus. Revenons deux ans plus tôt. La loi de finances rectificatives du 16 août 2022 met brutalement fin à la Contribution à l'Audiovisuel Public (CAP), plus prosaïquement au financement par la redevance. Selon quelles motivations ? Le doute demeure. Cette source n'était pas imperfectible - en France les recettes de la redevance étaient moins élevées que dans d'autres grands pays d'Europe - mais au moins elle assurait un financement équitable et surtout indépendant des vicissitudes de la politique. Choix a été fait de remplacer la redevance par l'affectation d'une fraction de la TVA. Mais ce mode de financement, pour être prolongé en 2025, devait s'accompagner d'un dispositif législatif ad hoc. La dissolution, en enterrant ce projet de loi, expose l'avenir à très court terme de l'audiovisuel public à un mécanisme de budgétisation.
Le RN les coudées franches à l'Assemblée nationale, l'audiovisuel public sera alors à la merci de son double dogme économique et politique. Une première étape d'assèchement avant de le transformer en média privé ?
Le mécanisme de la budgétisation rend, par définition, son objet dépendant d'un vote parlementaire. Je vous laisse en effet deviner ce qu'il adviendrait des ressources financières de Radio France ou de France Télévisions... Dans un théâtre, lorsqu'on veut « réduire la voilure », on s'attaque à la « marge artistique », c'est-à-dire au financement des activités de création, une fois les charges fixes de fonctionnement imputées. Par analogie, dans le cas de l'audiovisuel public, cette « marge artistique » désignerait la création et la production d'émissions originales. Lorsqu'elle est compressée, c'est la substantifique moelle de l'offre informationnelle et culturelle qui se délite. On peut donc craindre l'assèchement du service public, et la privatisation pourrait intervenir dans un deuxième temps, plus vraisemblablement « par appartements », de manière partielle. D'autant que du côté des médias privés, la privatisation totale est redoutée, et se heurterait à un mur : le « gâteau publicitaire » n'est pas extensible, il faudrait le partager, alors même que la dynamique publicitaire risque de se contracter - de 3,5 milliards d'euros en 2022, les recettes pourraient reculer à 3,1 milliards d'euros en 2030, selon les prévisions d'avant la crise politique et économique que nous traversons.
La privatisation de l'audiovisuel public permettrait, selon Jordan Bardella, d'engranger 3 milliards d'euros - une goutte d'eau toutefois dans l'océan des besoins de l'Etat -, et certes elle permettrait au RN de solder auprès de son électorat le sort de médias qu'il a érigés en épouvantails. Mais n'a-t-il pas plutôt intérêt à les conserver et à « contrôler » leurs instances, à l'instar de ce qu'ont entrepris les démocraties devenues illibérales (la Hongrie d'Orban, la Pologne du PiS, la Turquie d'Erdogan, etc.) ? Le premier Président de la cour des comptes Pierre Moscovici rappelle que « quand l'illibéralisme attaque, il le fait toujours contre les médias et les juges »...
Difficile de répondre à la place de Jordan Bardella, et encore moins d'émettre un quelconque conseil ! Les présidentes de Radio France (Sibyle Veil) et de France Télévisions (Delphine Ernotte) ont été reconduites récemment dans leur mandat. Procéder à leur éviction serait extrêmement délicat, et sans leur consentement placer des « relais » stratégiques au sein des organigrammes éditoriaux et de direction générale serait plus que compliqué. Enfin, Jordan Bardella n'ignore pas qu'entre l'audiovisuel public et le RN, la relation est épidermique. Les salariés du premier font leur travail de service public de l'information, au nom du pluralisme, en alternative aux médias privés ; les élus du second n'ont jamais cessé de vilipender ceux qu'ils considèrent comme des adversaires. Dès lors, la probabilité d'une immense mobilisation des corps sociaux de l'audiovisuel public, soutenue par une partie de la population, signifierait allumer un feu que le pouvoir en place aurait sans doute du mal à éteindre.
Mesure-t-on l'influence que les télévisions, radios et titres de presse écrite du groupe Bolloré (Canal +, CNews, C8, JDD, Paris Match, Europe 1, Voici...) exercent désormais sur la polarisation du débat politique et donc sur le vote des Français ?
Bien sûr, les médias du groupe Bolloré ont favorisé la visibilité des sujets de prédilection et des thèses du RN. Eric Ciotti est par ailleurs un fidèle de Vincent Bolloré. Mais l'essentiel de sa popularité médiatique, Jordan Bardella la doit au moins autant aux médias « amis » qu'à une stratégie de présence continue sur les réseaux sociaux remarquablement efficace. Ce que toute une génération de personnes politisées n'a pas anticipé, et ce que les plus jeunes générations ont, elles, accueilli avec gourmandise. Ces dernières ont été séduites par les stories TikTok et les messages simples d'un Jordan Bardella lui-même vingtenaire et au physique avantageux. Faut-il rappeler qu'en 2024, chez nombre de citoyens, l'information se résume à l'image et à la fulgurance de quelques phrases ? D'ailleurs, en matière d'information, la prédominance des réseaux sociaux et les menaces d'ingérence étrangères donnent une importance encore plus grande au maintien d'un puissant service public de l'audiovisuel. C'est un combat démocratique fondamental.
Justement, le groupe Bolloré pourrait-il alors lorgner tout ou partie du conglomérat public ?
Cette hypothèse fiction est peu plausible à contexte institutionnel et législatif constant. Mais si ce dernier venait à évoluer, en effet rien ou presque ne pourrait y faire obstacle. Presque étant le niveau européen. Des garde-fous existent, à condition qu'ils vivent.
Le Monde a révélé que le présentateur vedette du groupe Bolloré, Pascal Praud, avait été informé de la décision de dissolution dès 18 heures le 9 juin, c'est-à-dire bien avant le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale. L'indiscrétion aurait fuité de la bouche d'un des plus proches conseillers du chef de l'Etat qui lui avait recommandé la dissolution, Bruno Roger-Petit. L'anecdote est-elle symptomatique de l'influence que les médias Bolloré exercent au-delà même de leur audience : sur le substrat idéologique du débat politique ?
Ce fait anecdotique « dit » en effet beaucoup, et symboliquement nous ramène au champ des « valeurs ». Des télévisions, des radios, des titres de presse écrite aussi influents - mais aussi le 3e groupe mondial d'édition (Hachette) - peuvent-ils céder leur autonomie et avoir pour ligne informationnelle de servir un projet idéologique lui-même au service d'un projet politique ? A titre personnel, je ne m'y résigne pas. J'insiste : l'avenir des médias publics, le scrutin législatif, le comportement des entreprises convoquent un choix de valeurs.

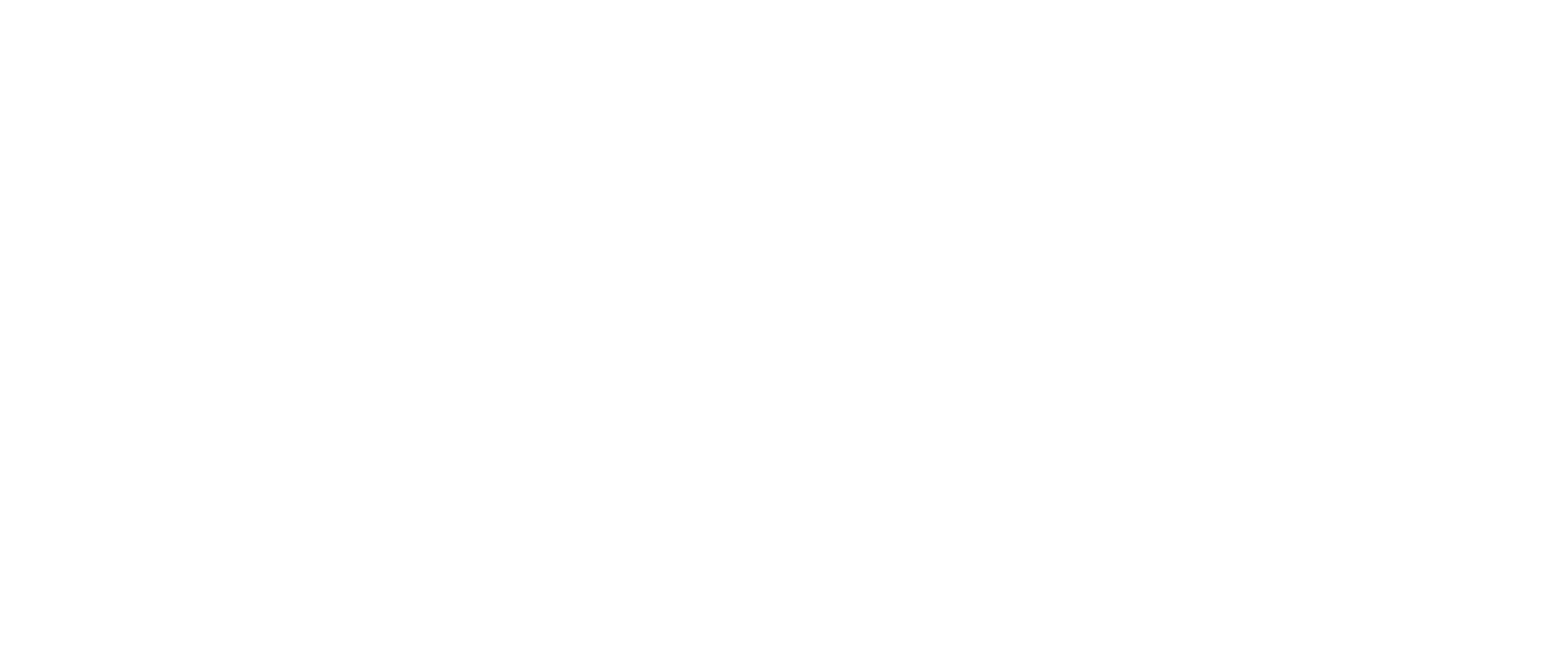
 En France, le grand décrochage des prix de l’électricité
En France, le grand décrochage des prix de l’électricité

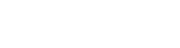
Sujets les + commentés