
LA TRIBUNE - Nous sommes en plein période d'élections européennes (l'interview a été réalisée fin mai en amont du Paris Air Forum, ndlr). Qu'attendez-vous à l'issue de ces élections et des futures institutions européennes, notamment pour soutenir la décarbonation de l'aviation ?
GUILLAUME FAURY - C'est un sujet important. Nous sommes une filière avec un impact global, mais la taille critique est la taille européenne et donc ces élections sont importantes. L'Europe a soutenu au fil des décennies son aviation, son industrie aérospatiale et il est important que cela continue. Pour autant, il y a un agenda très clair de décarbonation en Europe, aligné avec celui de la filière. Donc, ce qui va être important pour nous, c'est d'avoir de la continuité dans le soutien à la filière aérospatiale et l'aviation comme dans le soutien à la décarbonation. Toute la difficulté est d'arriver à faire les deux en même temps. C'est pour cela que nous avons besoin d'un travail efficace et coopératif dans le domaine industriel, entre les entreprises et les pouvoirs publics, en particulier européens.
Face à cette difficulté de l'Europe à accélérer, y a-t-il un risque de voir certains chantiers - comme Refuel Eu Aviation, le Net Zero Industry Act ou le Ciel unique européen - ne pas atteindre leur plein potentiel ?
Ce sont des programmes qui vont dans la bonne direction, mais pour lesquels nous avons des problèmes de vitesse d'exécution. Que ce soit sur le Ciel unique européen ou sur le développement des carburants durables pour l'aviation, dits SAF, nous avons besoin d'aller vite. C'est là que nous attendons les pouvoirs publics et où les pouvoirs publics attendent les industriels. C'est un jeu coopératif qui doit se mettre en place. Nous attendons des nouvelles institutions européennes de continuer sur cette lancée et d'accélérer leurs efforts en soutien de la transformation de notre filière, sur laquelle l'Europe est leader mondial.
Vous parlez de vitesse d'exécution. Nous voyons donc une Europe qui a du mal à accélérer, au contraire des États-Unis qui vont très vite avec un Inflation Reduction Act qui draine les investissements ou de la Chine qui cherche à redynamiser les investissements étrangers. Est-ce que ça peut redéfinir votre empreinte industrielle et celle de la filière ?
L'empreinte industrielle de la filière est très française et très européenne, même si nous avons des entreprises globales avec une empreinte industrielle forte en dehors d'Europe. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'une Europe qui aille beaucoup plus vite, qui soit beaucoup plus au service de l'innovation, qui soit moins bureaucratique, qui règlemente peut-être moins aussi. C'est un constat que font tous les industriels et je crois qu'il est aussi de plus en plus partagé par beaucoup de politiques.
Nous avons beaucoup de technologies qui arrivent. La caricature habituelle consiste à dire que face à une nouvelle technologie, les États-Unis innovent, l'Europe réglemente et la Chine planifie. Et réglementer n'est pas la meilleure façon pour aller vite au moment où il y a beaucoup de sujets de vitesse, de taille critique, d'échelle. Les États-Unis et la Chine sont beaucoup plus grands que les pays d'Europe pris individuellement, mais quand les pays d'Europe se mettent ensemble, ils arrivent à avoir une taille critique à peu près comparable aux deux autres grands blocs. C'est cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une Europe qui fédère, d'une Europe qui permet des coopérations et d'une Europe qui permet à la taille critique européenne de s'exprimer bien plus qu'aujourd'hui.
Au regard des aléas sanitaires et des risques géopolitiques, comment la filière a-t-elle mis un plan en marche pour sécuriser ses approvisionnements ? On pense d'abord au titane, mais il y a beaucoup d'autres matières et composants concernés.
Nous avons mis un plan en marche, comme beaucoup d'autres industries d'ailleurs, parce que le monde est en train de changer devant nous à toute vitesse. Nous étions avant le Covid dans un monde multipolaire, très ouvert, level playing field (avec des règles du jeu équitables, NDLR), très coopératif. En quelques années, ce monde a complètement changé avec des tensions géopolitiques considérables et une conscience beaucoup plus forte que l'accès aux ressources va être un avantage ou un désavantage compétitif. Dans ce contexte, cette industrie aujourd'hui très globale, qui s'approvisionne, vend ses produits et distribue ses services à l'échelle mondiale, a besoin d'être beaucoup plus résiliente face aux tensions géopolitiques et aux difficultés d'approvisionnement de matières premières ou de composants.
Nous sommes effectivement en train de nous restructurer pour être moins dépendants de points de défaillance uniques, ce que l'on appelle les single points of failure, dans une chaîne d'approvisionnement. Nous voulons dupliquer les sources d'approvisionnement, avec une dimension plus régionale pour être moins sensibles aux tensions géopolitiques, embargos, restrictions, difficultés d'accès ou prix qui seraient difficiles à assumer.
Au-delà de ça, il y a des sujets spécifiques sur les matériaux. Au sein de la filière, nous sommes coordonnés avec les autorités européennes et françaises qui s'occupent de l'accès à ces matériaux critiques, et nous avons aussi lancé des actions spécifiques. C'est ce que nous avons fait collectivement avec Aubert et Duval pour recréer une filière européenne pérenne dans le domaine des aciers et des métaux de haute technologie spécifiques à l'aviation, en particulier le titane mais pas seulement. Ensuite, chaque acteur prend aussi ses dispositions particulières.
A quelle échéance pensez-vous que cette filière sera sécurisée au niveau de ses approvisionnements ?
C'est un jeu permanent dans un monde qui va continuer à évoluer très vite. Nous ne pourrons jamais être complètement sécurisés parce que les choses bougent plus vite que les mouvements que nous pouvons faire dans la chaîne d'approvisionnement. Il faut se poser en permanence la question des risques principaux et se couvrir. Certains de ces risques sont communs à la filière et nous les traitons dans le cadre du Gifas, voire collectivement avec plusieurs filières ou au sein de l'Association européenne des industries aérospatiales et de défense (ASD). Puis, il y a des sujets individuels où chacun doit prendre ses précautions. Dans la filière, nous avons passé beaucoup de temps ces dernières années à travailler sur les sujets collectifs pour les traiter le mieux possible.
Parlons d'espace. On a le sentiment que le modèle européen est en train de s'effondrer : dans les lanceurs, le retour géographique va peut-être disparaître dans la compétition que vient de lancer l'Agence spatiale européenne (ESA) ; dans les satellites, il y a un vrai creux. Comment voyez-vous la filière spatiale européenne de demain ?
C'est exagéré de dire qu'il y a un effondrement du modèle européen. Il y a un bouleversement dans le domaine du spatial à l'échelle globale, avec quelques nouveaux acteurs, beaucoup d'argent investi en particulier aux États-Unis, des transitions de produits... Il faut sans doute séparer quelque peu les sujets pour essayer de les traiter correctement. Nous avons d'abord le sujet des lanceurs, où nous sommes dans une transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Il y a d'ailleurs eu une rupture d'offre entre les deux parce que la mise en vol d'Ariane 6 a été beaucoup plus longue que prévu, suite au Covid et à un certain nombre de raisons. Puis l'Europe a perdu son accès à l'espace en raison de l'attaque russe en Ukraine qui nous a coupé de Soyouz, et des accidents de Vega qui ont mis le programme au sol pour 2 ans. Nous sommes donc vraiment dans une situation très critique. Nous allons en sortir avec l'arrivée en vol d'Ariane 6 (prévue le 9 juillet, NDLR).
Nous retrouvons une capacité de lancement, mais pas du tout au niveau des États-Unis, qui ont un nombre de lancements annuels largement supérieur à 100 quand nous en avons fait deux l'an dernier en Europe. Nous avons vraiment un problème d'échelle très difficile à gérer et qui impose plus que jamais un travail collectif mais aussi compétitif. Il est vrai que les règles de retour géographique, avec lesquelles l'Europe a traditionnellement fait sa coopération, sont aujourd'hui rigides et pas très compétitives. Il faut les remettre en cause parce que nous avons besoin de faire évoluer notre modèle. Ce modèle n'est pas complètement obsolète, mais il est très bouleversé par ce qui se passe autour. Il faut donc s'adapter. C'est la vitesse à laquelle nous allons nous adapter qui va nous permettre de survivre. C'est très darwinien.
Il y a des initiatives sur les lanceurs et il y aura des opportunités de créer de la compétition. Les Européens auront, j'espère, la capacité à se retrouver collectivement autour de projets communs. Si nous avons seulement l'échelle nationale, nous n'avons aucune chance d'y arriver.
Qu'en est-il pour les satellites ?
Dans le domaine des satellites, les constellations comme Starlink ou les nouvelles technologies venues du Newspace remettent profondément en cause le modèle traditionnel. Là aussi, il faut être capable d'innover, d'aller vite. Nous en sommes capables individuellement, mais les satellites nécessitent aussi de gros investissements pour des séries en général relativement petites. Il faut donc être capable de maximiser nos efforts en commun et, peut-être, de faire bouger le modèle au niveau des acteurs et de la façon dont ils adressent le marché.
Les opportunités existent, à l'instar d'Iris² (constellation de satellites de télécommunications de l'Union européenne, NDLR). Nous savons qu'elle est difficile à saisir en raison de la complexité pour faire correspondre le budget avec les très grandes ambitions de l'Union européenne, la réalité industrielle et les nouvelles technologies à mettre en place. Les acteurs sont mobilisés et j'espère que nous allons y arriver.
Nous sommes donc dans une période de grands bouleversements, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'acteurs qui perdent de l'argent en ce moment. Il faut vraiment jouer collectif et je ne suis pas pessimiste sur le fait que nous allons y arriver.
Dans le domaine de la défense, comment voyez-vous la coopération européenne à l'aune des événements dramatiques en Ukraine, alors que plusieurs programmes communs sont en gestation ?
Nous avons eu, en Europe, une prise de conscience très forte de la criticité de la défense et de la sécurité avec le retour de la guerre à nos frontières. Nous n'y étions plus habitués depuis très longtemps, et nous avions assez largement baissé la garde. Au sein de l'Union européenne, nous dépensons cinq fois moins qu'aux États-Unis pour s'équiper en matériel de défense. Et cet effort est aussi différent en nature : les États-Unis achètent quasiment exclusivement américain. Nous, nous achetons entre les deux tiers et les trois quarts de notre matériel hors d'Europe. Et ces acquisitions sont fragmentées parce que faites bien davantage au niveau national qu'européen.
Pour s'en sortir, il faut faire le plus possible de coopérations pour retrouver de l'effet d'échelle, faire de l'export - l'accès à l'export est absolument essentiel - et trouver des astuces. En Europe, nous faisons ainsi très bien de la dualité avec des développements technologiques de plateformes qui sont à la fois civiles et militaires, ce qui permet de retrouver des effets d'échelle à travers l'accès au marché civil.
En tant que président du Gifas, pensez-vous qu'il faille toujours privilégier un axe franco-allemand ou alors diversifier les coopérations françaises ?
Quand on parle de coopération en Europe, a fortiori depuis Paris, le premier partenaire vers lequel il est logique de se tourner, c'est effectivement l'Allemagne. Nos deux pays représentent à eux seuls presque 50 % du PIB de l'Union Européenne. Il y a en plus beaucoup de complémentarité industrielle et une vision tout de même assez proche dans la plupart des cas, pas toujours, qui en font un partenaire incontournable. C'est un partenaire dont nous avons besoin et dont nous avons envie. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres acteurs importants en Europe. Il faut être pragmatique et être capable de regarder des coopérations plus élargies. Il y a eu des grands programmes réussis avec souvent 3, 4 ou 5 acteurs. C'est ce que nous avons fait récemment avec le FCAS. Nous pouvons regarder vers l'Italie, vers l'Espagne et pourquoi pas demain vers la Pologne.
Le grand nom qui manque désormais dans le format Union Européenne, c'est la Grande-Bretagne. Nous les industriels, nous sommes absolument convaincus que nous avons besoin d'accords de défense et de sécurité entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, pour tirer parti de l'effet d'échelle mais aussi des très fortes compétences britanniques en la matière.
L'intelligence artificielle (IA) devient incontournable dans tous les secteurs, et s'impose comme un facteur différenciant. Comment accélérer aujourd'hui l'intégration de l'IA à l'échelle de la supply chain ?
On parle beaucoup de l'intelligence artificielle depuis le lancement de ChatGPT, mais cela fait très longtemps que les industriels de haute technologie dans l'aéronautique et la défense l'utilisent. Ce qui est très nouveau, c'est l'intelligence artificielle générative, la Gen AI. Cela produit une puissance de feu assez incroyable, en faisant la somme de toutes les connaissances disponibles pour les mettre au service de l'analyse, de la création ou du développement de contenus. C'est même un facteur de changement très important de la compétitivité. Il faut que ce soit sur la liste des priorités des chefs d'entreprise, des responsables de filière et des pouvoirs publics.
Si nous nous en emparons moins bien que les filières concurrentes dans d'autres pays, nous risquons de prendre du retard. Inversement, si nous nous en emparons bien, cela peut être un accélérateur aussi important qu'Internet il y a quelques décennies, voire davantage. Il faut s'assurer que nous ne sommes pas en train de prendre du retard sur l'accès à l'IA, aux données, à la capacité de calcul... autant d'éléments importants pour pouvoir utiliser cet accélérateur. Je ne crois pas que nous allons voir un « grand soir » de l'IA. Cela va plutôt venir progressivement. Il faut que les entreprises s'en emparent. C'est le cas des grands groupes aujourd'hui, même si cela prend plus de temps pour arriver à des cas concrets que ce que nous imaginions au tout début. Il faut continuer à travailler. C'est un sujet d'actualité, un sujet d'investissement, un sujet pour lequel il faut préparer les compétences, les savoir-faire, l'infrastructure et l'utiliser comme catalyseur de performances au fur et à mesure.
Sur le quantique, estimez-vous que cette technologie va révolutionner le monde industriel et notamment la filière aéronautique-défense ?
Nous y croyons et nous y travaillons. La vitesse à laquelle cela va se déployer, les cas d'usage sur lesquels cela va être pertinent ne sont encore pas tous parfaitement identifiés. On voit que dans tout ce qui est cyber, crypto, simulation, tous les domaines où la puissance de calcul est essentielle, cela peut fondamentalement changer la donne avec des points de bascule assez brutaux. Donc il faut s'y préparer. Cela fait partie des sujets comme l'IA qui sont des accélérateurs, qui sont à la fois des opportunités et des menaces.
Que ce soit le quantique ou l'intelligence artificielle, où vont se situer les impacts pour la filière aéronautique et défense ? Plutôt au niveau de la conception, de la production, des performances opérationnelles ?
L'impact de l'IA ou du quantique, nous allons le voir très clairement au niveau de la conception, de la production, de la maintenance et plus largement de l'ensemble des métiers. Ce sont des outils supplémentaires dans un monde qui est de plus en plus complexe, numérique et connecté. Cela représente une opportunité pour être plus efficaces, plus rapides, plus compétitifs.
On observe clairement le potentiel de l'IA générative ou du quantique pour automatiser des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, pour le faire très vite et à grande échelle avec une technologie quantique qui donnera la puissance de calcul nécessaire. Elle ne remplacera pas ce que nous avons déjà fait dans le passé dans le domaine de l'invention, de la création, et du développement de nouveaux produits, mais elle pourra potentiellement décupler ces capacités d'innovation.

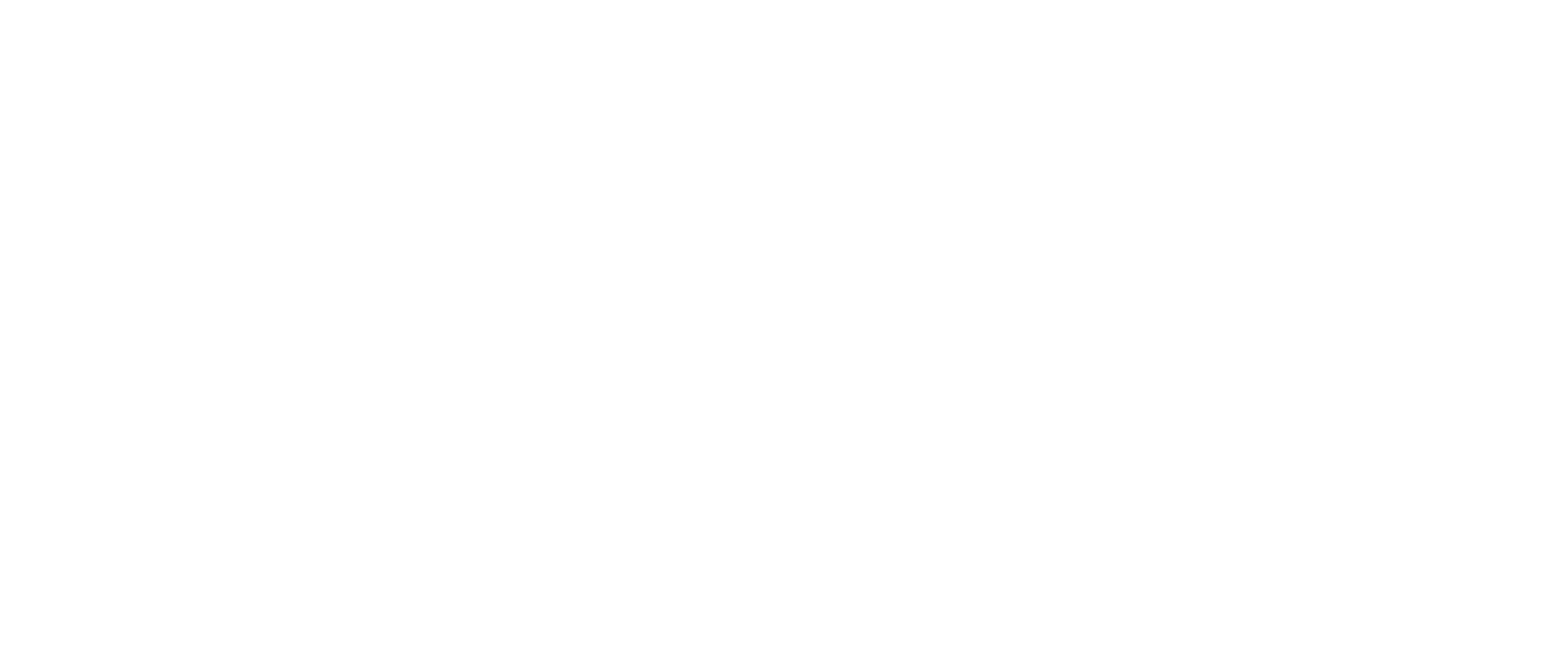
 Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers
Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers

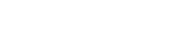
Sujets les + commentés