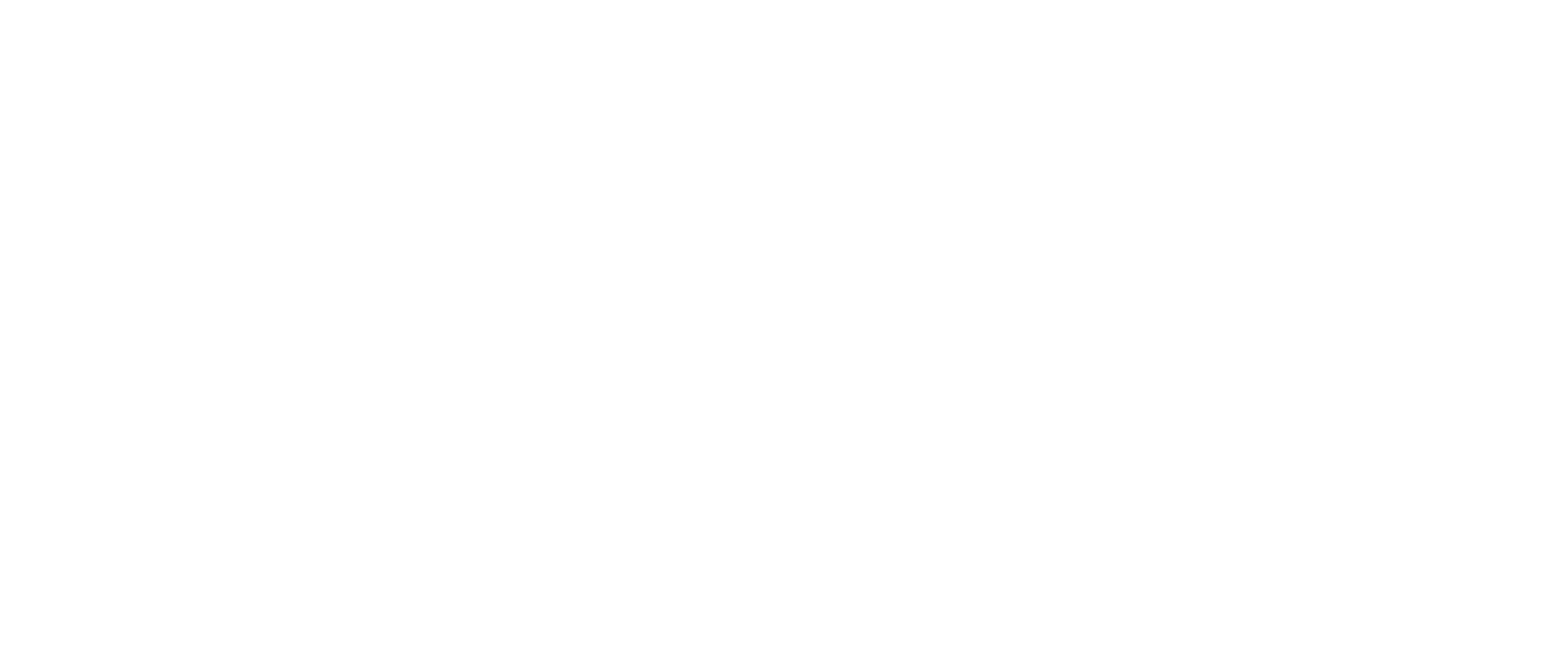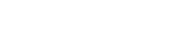Omaha Beach. 80 ans après, il n'a pas oublié. C'était la nuit, deux jours après le D-Day. Débarqué au petit matin, Victor Brombert s'endort, épuisé, dans un champ, enveloppé dans une couverture. Une fusée éclairante, le hurlement d'un Stuka qui plonge en piqué. Réveillé en sursaut, le GI s'accroche au sol humide, muscles tendus, pour échapper à la mitraille. Peur viscérale. « Je ne savais pas prier mais je savais comment faire un vœu », raconte le professeur émérite de littérature française, dans un entretien vidéo, depuis sa maison de Princeton. « Je me suis fait la promesse que, si je survivais, jamais de ma vie je ne me plaindrais. Quoi qu'il arrive, tout ce qui suivrait serait un cadeau précieux. »
Victor Brombert a accepté de revenir pour les lecteurs de La Tribune Dimanche sur cette page de sa vie, longtemps occultée, jusqu'à la publication de ses mémoires en 2002* et son retour sur les lieux, en 2004, à l'occasion du soixantième anniversaire du jour J. Esprit ludique et enjoué, Victor Brombert alterne l'anglais et le français, entre éclats de rire et pointes d'humour. « L'archéologie de la mémoire » ne facilite pas le déchiffrement du passé, note le centenaire. Les événements ont tendance à se mélanger. Les souvenirs reviennent, par bribes, des visions instantanées, discontinues, qui finissent par se fondre dans une simultanéité discordante.
Au volant de sa Jeep, le master sergent s'était concentré pour ne pas s'enliser, rester sur les planches posées sur le sable et grimper au plus vite vers le surplomb. « Je vois la plage jonchée de débris, de barges à moitié coulées, de véhicules accidentés, de ceintures de munitions abandonnées. Les pieux minés. Les obstacles antichars. Un soldat blessé, la tête couverte de bandages, appuyé contre un muret, en attendant d'être évacué. » Ensuite, les semaines de combat dans le bocage normand, la forêt de Cerisy, la percée de Saint-Lô, sous un tapis de bombes, ont aussi laissé des traces. « Je me souviens de l'odeur des vaches mortes et des cadavres en uniforme, ceux des conducteurs de chars à moitié brûlés, leurs corps repliés sur les tourelles, comme momifiés par la lave d'un volcan. »
« À Omaha Beach, j'ai compris que je n'étais pas un héros »
Il avait débarqué trois jours après les premières vagues d'assaut, avec la 2e division blindée. Devenue légendaire sous le nom de « Hell on Wheels » (l'Enfer sur roues) à l'époque où elle était commandée par le général Patton, l'unité était censée venir soutenir les deux divisions d'infanterie - la 1re et la 29e - qui avaient subi de très lourdes pertes. Victor Brombert et ses camarades avaient évité le pire, mais la réalité de la guerre a vite dissipé leur enthousiasme. « À Omaha Beach, comme plus tard dans les Ardennes, dit-il, j'ai compris que je n'étais pas un héros. Il fallait gagner cette guerre mais sans prendre le moindre plaisir à la faire. » Victor Brombert, 19 ans, faisait partie d'une military intelligence team, une unité de six soldats sous les ordres d'un capitaine, avec deux Jeep et une remorque. Réparties dans les différentes unités de l'US Army, ces équipes comprenaient des réfugiés européens - juifs Allemands et Autrichiens pour la plupart, mais pas seulement -, naturalisés américains à l'issue d'une formation de quelques mois à Camp Ritchie, un ancien camp d'entraînement de la National Guard, dans le Maryland. Leur connaissance des langues étrangères - l'allemand, le français et l'italien en particulier - les rendait particulièrement utiles pour l'interrogation des prisonniers, la collecte de renseignements auprès de la population et la liaison avec la Résistance française.
L'accueil mitigé des Normands
Les Ritchie Boys avaient été prévenus. Des Français avaient sans doute noué des relations étroites avec les Allemands. Il ne serait pas toujours facile d'obtenir des informations sûres et précises. Et effectivement, les paysans interrogés sur place donnaient le plus souvent des réponses évasives. Des indications contradictoires sur les chemins minés ou l'emplacement des nids de mitrailleuses cachés derrière les haies. « P't'être ben qu'oui, p't'être ben qu'non : j'ai pu constater que cette formule attribuée aux Normands n'était pas une caricature », affirme le vétéran. « J'étais déçu parce que je pensais que les Français auraient tiré la leçon des dissensions politiques des années 1930 et du régime de Vichy, mais nos questions suscitaient des dénonciations, souvent motivées par des animosités personnelles ou idéologiques. »
La Normandie accueillait ses libérateurs avec des sentiments mitigés. La prospérité de ses habitants n'avait pas trop souffert sous l'Occupation. Les pénuries dans d'autres régions faisaient fleurir le marché noir. Les bombardements alliés causaient un grand nombre de victimes civiles et de destructions.
Une adolescence parisienne
Débarquer en France avec les troupes américaines et libérer le pays, Victor Brombert en rêvait depuis qu'il avait quitté l'Hexagone en juillet 1941 pour se réfugier aux États-Unis. Arrivé en 1933, en provenance de Leipzig, avec ses parents qui fuyaient le nazisme, il était devenu un vrai Parisien. Une adolescence insouciante de « fils à papa », dans le 16e arrondissement, entre la Muette et Passy. Études secondaires au lycée Janson-de-Sailly, cours de tennis au Racing Club, vacances à Cabourg, Deauville et Trouville. Tout bascule en septembre 1939 avec la déclaration de guerre, l'offensive allemande de mai 1940 et l'exode vers Bordeaux, puis Nice. En octobre 1940, la promulgation du statut des juifs met fin aux illusions sur le régime de Vichy. En juillet 1941, Victor et ses parents rejoignent Séville d'où ils embarquent pour New York à bord d'un bananier. « Je me sentais très français et j'espérais que les États-Unis entreraient en guerre aux côtés de l'Angleterre. Après l'attaque de Pearl Harbor, j'ai attendu tous les jours la convocation de l'armée américaine. »
Au début du mois d'août 1944, les Américains laissent à la division blindée du général Leclerc la tâche de libérer Paris. Le 26 août, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, sous les acclamations de la foule. En bivouac avec son unité à Mantes-Gassicourt (future Mantes-la-Jolie), Victor Brombert ne résiste pas à l'envie de revoir les lieux de son adolescence jusqu'à cet immeuble du boulevard Voltaire, où il monte quatre à quatre l'escalier jusqu'au domicile de Danielle Wolf, son grand amour de l'été 1939. « Où est Dany ? », demande-t-il. « Déportée », répond une vieille femme. Entre-temps, Danielle Wolf s'était mariée. Elle et son enfant finirent à Auschwitz.
Deux jours plus tôt, De Gaulle a scellé l'acte fondateur du mythe gaulliste de l'« autolibération » dans son discours de l'Hôtel de Ville. « Paris ! Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! » Paris « libéré par son peuple avec le concours des armées de la France » et de « la France tout entière », poursuit le général, sans un mot pour les Alliés et la Résistance. « Chaque pays a sa mythologie. Jeanne d'Arc, Napoléon, la France généreuse, la France libératrice, la belle France, la grande France », commente Victor Brombert. « C'était un grand mensonge. La France ne se serait pas libérée sans l'engagement des États-Unis et de la Russie contre l'Allemagne nazie. »
Démobilisé en décembre 1945, après une mission de dénazification dans la Sarre et une affectation au quartier général des forces d'occupation à Berlin, Victor Brombert reprend ses études, à l'âge de 23 ans, avec une bourse du GI Bill of Rights, le programme fédéral permettant aux militaires de poursuivre des études supérieures. L'apatride trouve enfin sa place. Il vivra sur un campus, au milieu des livres, loin de la fureur et du chaos. Apprendre, enseigner, partager son amour de la littérature : ce sera sa vocation.
Sa « french connection » est intacte
Professeur de littérature française à Yale et à Princeton, Victor Brombert n'a jamais cessé d'entretenir une relation intime avec la France. Une french connection, nourrie de la lecture de Molière, Voltaire, Stendhal, Proust et Baudelaire. « Mon attachement personnel à la France est resté étonnamment intact. Ma scolarité, mes amis, mon éducation sentimentale, politique et culturelle, mes rêves de jeunesse étaient associés à la France. Comme si j'étais destiné à défendre la France en présence d'Américains sceptiques et à vanter les États-Unis face aux critiques des Européens ».
Parvenu à « l'âge biblique » de 100 ans, Victor Brombert conserve une joie de vivre tempérée par la conscience de la fragilité des choses. En novembre 2023, le professeur érudit a célébré son anniversaire en publiant son dernier livre, une collection d'essais sur ses auteurs favoris**. Montaigne y figure en bonne place comme un modèle d'éducation à « la connaissance de soi, la résistance à toute autorité doctrinaire, la mobilité intellectuelle et l'ouverture au changement ».
À l'heure de la polarisation qui mine le débat public des deux côtés de l'Atlantique, Victor Brombert s'inquiète pour l'avenir de la démocratie libérale quand les électeurs se tournent vers le populisme et la violence. « Une recette pour la dictature, dit-il. Nous n'avons toujours pas dépassé l'âge tribal, le racisme et l'antisémitisme sous ses différentes formes. »
« Aucune cérémonie ne dira la réalité de la guerre »
Victor Brombert a attendu soixante ans pour retourner, en 2004, à Omaha Beach. Depuis 1984, sous l'impulsion de François Mitterrand, le rassemblement mémoriel autour du D-Day s'impose comme un incontournable rendez-vous diplomatique. « Aucun monument, aucune cérémonie ne pourra jamais dire la réalité de la guerre », lâche ce grand témoin, réticent envers cette instrumentalisation politique, troublé par le décalage entre l'atmosphère festive de ces grands shows et les images qui continuent à le hanter. « S'il y avait une leçon à retenir, ajoute-t-il, c'est que la notion de crime de guerre est fallacieuse. La guerre elle-même est un crime, même si certaines guerres sont inévitables et doivent être gagnées précisément par ceux qui la haïssent. »
_____
* Les Trains du souvenir. Paris - New York - Omaha Beach - Berlin, Éditions de Fallois, 2005. (Titre original : Trains of thought. Paris to Omaha Beach, Memories of a Wartime Youth, Norton, 2002.)
** The Pensive Citadel, The University of Chicago Press, 2023.