
Il arrive au petit matin avec une valise cabine, un gobelet de boisson chaude à la main et un léger sourire flegmatique aux lèvres. Il est de passage à Paris, avant de partir vers Athènes pour une conférence internationale avec les régulateurs financiers, puis de rejoindre des bureaux à Francfort. Près de vingt-cinq ans passés dans le groupe Danone, dont quatre années en qualité de PDG, qui se termineront par un départ abrupt en 2021. Les fonds activistes n'étaient plus vraiment sous le charme de ses initiatives en faveur du climat et du social. Emmanuel Faber, désormais président de l'ISSB (International Sustainability Standards Board), savoure son nouveau job. Il est passé du laitage au faîtage... de l'économie mondiale, rien que ça. « C'est un privilège incroyable de faire ce que je fais en ce moment », glisse-t-il en posant son gobelet avec gourmandise. Et en savourant intérieurement sa revanche.
LA TRIBUNE DIMANCHE - Qu'est-ce qu'au juste l'ISSB ? Quels sont ses objectifs ?
EMMANUEL FABER - L'ISSB a été créé en 2021 lors de la COP26 de Glasgow, à la demande de différentes organisations internationales comme le G7, le G20, l'OCDE, la Banque mondiale ou encore le FMI. Nous sommes rattachés à la fondation IFRS [International Financial Reporting Standards], qui définit les normes comptables dans 144 pays. Avec l'ISSB, l'idée est d'intégrer au sein même des normes comptables des indicateurs capables de montrer, clairement, comment les entreprises sont exposées aux risques de durabilité. Par exemple, si une entreprise estime qu'une de ses usines n'aura plus d'eau d'ici dix ans, les coûts nécessaires à la fermeture de cette usine doivent être signalés dans la partie « risques » du bilan financier. C'est un changement majeur, qui permet de rendre compte de façon fidèle et sincère de la situation comptable de l'entreprise sur l'ensemble des paramètres, y compris climatiques et sociaux. Cette comptabilité devient du coup celle des dirigeants, des investisseurs et des banquiers.
Est-ce à dire que les nombreux indicateurs « verts » lancés depuis le début du siècle, et largement utilisés par les entreprises, n'étaient pas efficaces ?
Disons que je n'ai pas la preuve de l'inverse. La floraison depuis dix ou quinze ans de centaines d'indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, montre qu'il y a un besoin d'exprimer des éléments que la comptabilité n'arrivait pas, jusqu'alors, à refléter pour les investisseurs et les entreprises. Face à cette surabondance d'indicateurs, personne n'arrive vraiment à prendre de décisions. Cela montre la limite d'un système, que certains qualifient de « soupe à l'alphabet ». Cette opacité permet à ceux qui ne font rien pour la transition écologique et sociale de prétendre l'inverse et, plus grave encore, ne donne aucun avantage à ceux qui agissent réellement.
Où en est aujourd'hui l'ISSB ? À quel moment ces nouvelles normes comptables durables deviendront-elles effectives ?
L'ISSB a officiellement démarré ses activités début 2022, et en juillet 2023 les normes ont été homologuées par l'Iosco [International Organization of Securities Commissions], l'organisme qui regroupe les régulateurs financiers de près de 130 pays, soit 95 % de la capitalisation boursière mondiale. Dans la foulée, l'Iosco a appelé ses membres à mettre en œuvre les normes ISSB. Il y a quelques jours, nous avons annoncé qu'une première cohorte d'une vingtaine de pays majeurs, parmi lesquels l'Union Européenne, grâce à notre mécanisme d'interopérabilité conjoint, la Chine, la Turquie, le Brésil, le Japon ou encore le Canada, ont décidé d'utiliser nos normes et entreprennent des démarches pour le faire. Le momentum est exceptionnel : cette première cohorte représente plus de la moitié du PIB mondial, 40 % de la capitalisation boursière et plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Ces pays mettront deux, trois ou quatre ans pour déployer nos normes. Quand nous aurons atteint cette réalité, nous serons arrivés à un point de non-retour pour l'économie mondiale, qui aura un effet d'entraînement sur tous les autres pays.
Les États-Unis ne se sont pas engagés sur les normes ISSB. Pourquoi ?
Le cas particulier, ce sont en effet les États-Unis, qui avaient un projet de normes assez semblable sur le climat, porté par la SEC [Securities and Exchange Commission], le gendarme américain des marchés financiers. Mais face à la situation politique américaine, qui place les enjeux de durabilité dans une approche partisane, la SEC a été très attaquée sur ce projet. Elle a fait une proposition révisée à la baisse en avril dernier et a évoqué pour nos normes l'hypothèse d'une éventuelle équivalence en fonction de leur succès international. Cette proposition pourrait au mieux s'appliquer à la fin de cette année. Mais tout dépend, encore une fois, de la situation politique à l'issue de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. De son côté, la Californie a d'ores et déjà légiféré en octobre dernier sur l'obligation, pour toutes les entreprises d'une certaine taille mondiale, de faire du reporting climatique, avec une norme très proche de la nôtre et qui y fait directement référence.
Cette situation aux États-Unis démontre, en creux, que la mise en œuvre des approches durables reste dépendante de l'action politique...
Oui et non. Ce qui fait la force de notre démarche, c'est que nous ne faisons justement pas de politique. Nous ne sommes pas là pour dire ce qui est « bien » ou ce qui est « mal » sur les plans climatique ou social. Nous sommes là pour traduire en langage économique clair les risques et opportunités considérant toute la chaîne de valeur d'une entreprise, en regardant à court, à moyen et à long terme. Il s'agit ni plus ni moins de réécrire le code source de l'économie, en fournissant des outils capables d'orienter l'allocation de capital en fonction de la capacité des entreprises à faire face à la transition, ce qui aboutira à des économies plus résilientes dans un monde qui aura été transformé par le climat, y compris sur le volet social inhérent à cette transition. J'insiste sur ce dernier point, et je le dis depuis quinze ans : le social sera soit un facilitateur, soit un point bloquant pour la transition. On l'a vu en France avec les Gilets jaunes ou, plus récemment, avec le mouvement des agriculteurs.
Pensez-vous que les normes que vous déployez permettront réellement d'orienter l'économie vers une logique durable ? Ce n'est pas un peu utopique ?
Je suis certain de notre démarche, car elle est pragmatique. La question est plutôt du côté des politiques publiques, dont les incitations devraient diriger les flux financiers. Aujourd'hui, il y a en gros 400 000 milliards de dollars d'outils financiers dans le monde, dont 100 000 milliards de capitalisation boursière et 300 000 milliards de dette. À la dernière COP, les gouvernements se battaient pour boucler un fonds en faveur du climat de 100 milliards de dollars. Si le marché, avec nos normes, peut flécher ne serait-ce que 1 % des outils financiers dans le monde, ce sont 4 000 milliards de dollars qui iront en faveur de la transition, soit quarante fois plus, et cela tous les ans. Je continue de dire que les meilleurs alliés des politiques publiques en matière de durabilité, ce sont les marchés de capitaux. Et plus les marchés auront adopté notre langage, plus il sera difficile de remettre en cause ces normes qui ne seront non plus des normes de conformité, mais tout simplement des normes comptables utilisées par l'économie. Avant qu'un gouvernement vienne essayer de défaire ça... À l'inverse, il y aura besoin de politiques publiques engagées pour créer les risques et les opportunités de transition pour l'économie.
Les entreprises qui appliqueront ces normes bénéficieront-elles d'un réel avantage concurrentiel ?
C'est tout leur intérêt. Nous ne faisons pas de la conformité, nous faisons de la stratégie. Les questions stratégiques de durabilité n'ont pas de langage de décision aujourd'hui. Avec nos normes, une entreprise va pouvoir expliciter ses propres décisions dans ce domaine, sa gestion des risques, ses orientations stratégiques et son financement. Pour la première fois, les marchés pourront mettre un prix sur l'exposition et la préparation des entreprises face à ces évolutions. Ce prix relatif, c'est celui du coût du capital. Ce sera vrai pour les fonds propres, avec une prime de risque ou l'inverse entre un concurrent et un autre, et ce sera vrai pour la dette. Le comité de Bâle de supervision bancaire a par exemple annoncé qu'il allait utiliser nos normes pour ses travaux intégrant le climat dans les ratios de capital des banques. En fonction de la température de son portefeuille, une banque verra ses ratios de capital affectés d'une prime de risque, ce qui se traduira directement soit dans ses marges, soit dans son coût de crédit à ses clients. On parle donc bien de facteurs de compétitivité. Le changement climatique va révolutionner les avantages concurrentiels. Et nous proposons des outils pour aider la finance à l'intégrer dans ses décisions, à la disposition du marché et des régulateurs.
Sur le front européen, les entreprises sont d'ores et déjà en prise avec le reporting « extra-financier », à savoir la prise en compte des critères sociaux et environnementaux au sein des bilans. La directive qui encadre cette démarche est appelée CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive : Directive sur les rapports de développement durable des entreprises) et concerne notamment dès cette année les entreprises cotées de plus de 500 salariés pour leur rapport annuel couvrant 2024. Puis progressivement, jusqu'en 2029, cette directive s'étendra à davantage d'entreprises, et concernera entre autres les PME. Si la CSRD est très largement saluée dans ses ambitions en matière de durabilité, faisant de l'Europe une pionnière en matière de reporting social et environnemental, elle est aussi jugée par bon nombre d'entreprises comme complexe, avec une structure totale de 12 normes de durabilité. En septembre dernier, la CPME qualifiait ainsi la CSRD « de fardeau normatif ». L'origine de cette sentence ? La double matérialité. La CSRD ne se limite pas en effet aux risques induits par l'environnement et par le social sur l'activité de l'entreprise, à savoir la simple matérialité. La directive englobe également les impacts négatifs et positifs de l'activité même de l'entreprise sur son environnement économique, naturel et social. Une double matérialité louable, mais qui demande un effort important pour beaucoup de PME.L'Europe, pionnière ambitieuse

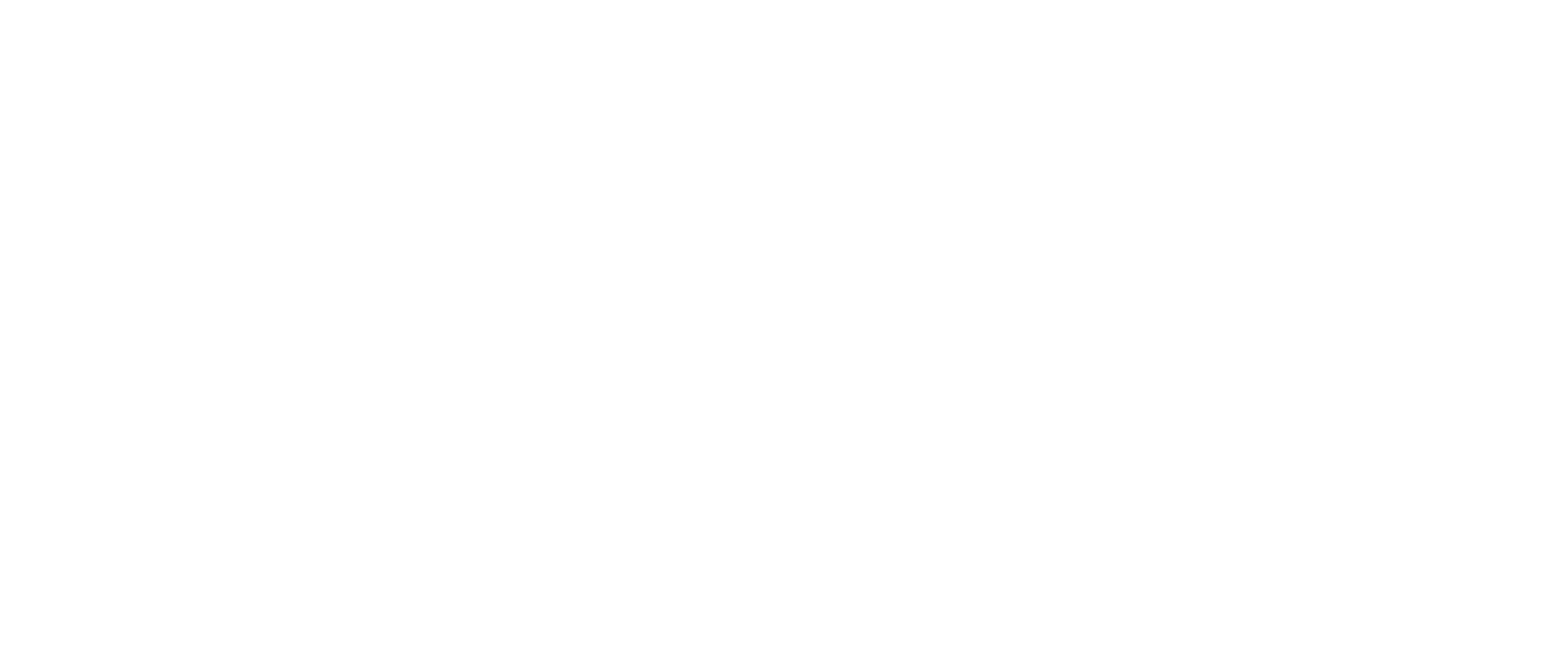
 En France, le grand décrochage des prix de l’électricité
En France, le grand décrochage des prix de l’électricité

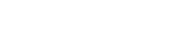
Sujets les + commentés