
Et pourtant, nous avons peu débattu d'une nécessité pour y parvenir : notre renaissance industrielle.
Alors, commençons par dresser un constat simple à ce sujet.
On peut se targuer de plus de 300 usines ouvertes sur les trois ans, c'est un bon marqueur de dynamiques territoriales. On peut aussi souligner l'accroissement de l'emploi dans l'industrie +20.000 par an, avec prudence toutefois, car il en faudrait le triple.
Mais en termes économiques, le bilan est plus nuancé, pour ne pas dire inquiétant. Hors inflation, la création de richesse liée à l'industrie a diminué en France de -5% entre 2019 et 2022 quand elle augmente sur la même période de +5% en Europe. Le « juge de paix », selon Louis Gallois et Pierre André de Chalendar, à savoir la balance commerciale industrielle de notre pays, reste abyssal à -60 milliards d'euros, quand globalement l'Europe est exportatrice nette de biens manufacturiers. Cela en dit long sur le chemin à parcourir.
Le volontarisme politique est indispensable et bienvenu, mais les faits sont têtus alors que nous poursuivons cet objectif de réindustrialisation depuis 2009 et les États généraux de l'industrie.
D'où cette question pas si ingénue : ne devrions-nous pas changer d'approche ?
Si ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des évidences qui se sont imposées à nous : le potentiel de réindustrialisation par la densification de notre tissu industriel, composé en grande partie par les PMI et ETI est deux fois plus important que celui des filières dites « nouvelles ». Les projets de diversification ou d'extension des productions déjà existantes se réalisent en deux ou trois ans, tandis que le cycle des startups industrielles, du laboratoire de recherche à la première usine véritable, est nettement plus long, de dix ans environ. Par millions d'euros investis, les petits projets des PMI créent 10 à 15 fois plus d'emplois que les grands projets et cela n'est pas indifférent pour viser le plein emploi.
Densifier notre tissu industriel recèle ainsi de plus d'emplois, plus d'agilité, plus de potentiel... Et malgré cela, nous avons tout misé ou presque sur les innovations de rupture, symbolisées par les startups puis les gigafactories. Il faut rééquilibrer nos politiques industrielles.
Car les deux sont complémentaires : comment croire pouvoir être un leader mondial, un virtuose de l'industrie verte, du spatial ou de tout autre secteur, sans maîtriser ses gammes et disposer d'un socle solide de savoirs industriels. Un simple exemple : 80% des compétences nécessaires pour créer la filière « hydrogène » sont en fait des métiers industriels classiques, de la métallurgie à mécanique. Or ce sont parfois des métiers déjà en tension, ce qui en fait des freins. Il ne suffit pas de tirer par « le haut » avec des paris technologiques, plus ou moins fous, plus ou moins audacieux. Encore faut-il être en mesure de les soutenir grâce à un tissu industriel suffisamment armé.
D'ailleurs, pendant les Trente Glorieuses, les grandes filières « gaullo-pompidoliennes » qui font encore notre fierté, l'aéronautique, le nucléaire, le train à grande vitesse, ont profité du socle d'une industrie « de base », soutenue à l'époque par l'équipement des ménages (voiture, électroménager, etc.) et d'où sont issues des cohortes d'ingénieurs et de techniciens.
Alors entre la « Start-up Nation » et le « Gigafactory-land », ne passons pas à côté du bon sens industriel, à savoir des sites « juste à la bonne taille » pour nos territoires et nos bassins de vie. Orientons aussi des soutiens publics vers ces projets-là, comme nous l'avons fait avec succès pendant la crise du Covid. Montrons l'industrie non pas « telle qu'elle était », mais « telle qu'elle est » ; non pas des centaines d'opérateurs à la chaine derrière des murs de briques, sous les sheds et l'œil de la grande cheminée qui fume, mais très souvent des ateliers où on travaille sur des projets en équipe, des usines qui rendent fières et qui sont si propres qu'on pourrait « pique-niquer par terre ». Formons dans les territoires pour les territoires, où nous sommes nombreux à vouloir vivre. Promouvons le Made in France même s'il faut « faire du judo » avec l'Europe pour cela : dans les achats publics, les achats interentreprises, dans notre propre consommation quand nous en avons les moyens. Fléchons une partie de notre épargne, même modeste, vers notre outil productif. Inventons les circuits courts et la circularité afin de résoudre un dilemme fondamental, celui du « pas cher, pas durable » et du « pas cher, pas souverain ». Simplement, remettons le « produire au cœur du projet de la France et de ses territoires.
Tout cela constitue un aggiornamento profond. Cette « nouvelle grammaire » de nos politiques industrielles nous permettra de réindustrialiser vraiment. Nous en avons la capacité si nous mobilisons ensemble nos atouts, si nous savons faire preuve d'humilité, de volonté et de persévérance.
____
(*) Olivier Lluansi, enseignant à l'Ecole des mines et à l'ESCP Business School, chargé d'une mission gouvernementale sur l'avenir de nos politiques industrielles et auteur de « Les Néo-industriels : l'avènement de notre renaissance industrielle » (éditions les Déviations Mai 2023).

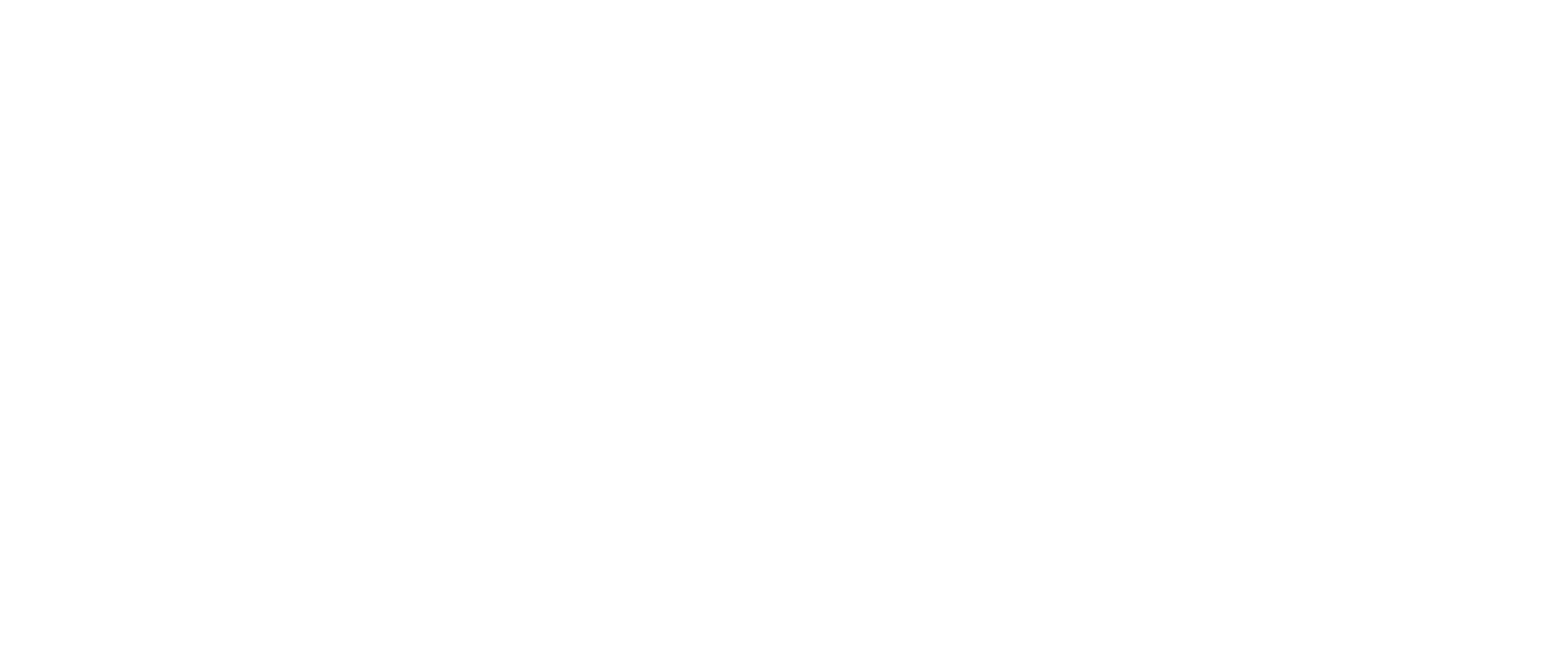
 Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français
Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

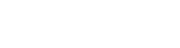
Sujets les + commentés