
PHILIPPE BOYER - Vous avez écrit plusieurs ouvrages remarqués sur notre condition numérique : « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention » dans lequel vous analysiez l'économie de l'attention. Puis, « Tempête dans le bocal », annonçant la plateformisation du monde et enfin, à l'automne dernier, « Submersion » décrivant ce torrent numérique qui, au sens propre, a englouti nos vies. À chaque fois, le fil conducteur de vos ouvrages revient sur l'idée que nous vivons dans un monde où nous sommes « calculés » par des outils numériques qui savent presque tout de nous et nous influencent dans nos choix et décisions. Avons-nous atteint le paroxysme de cette société faite de données, « dataifiée » comme on le dit, ou bien n'en sommes-nous encore qu'au début ?
BRUNO PATINO - Pour remettre les choses en perspective, cette ère numérique s'est construite en plusieurs phases. Il y a d'abord eu la décennie 1990 jusqu'au début des années 2000. Cette phase correspond à la découverte et la généralisation du Web et ses services.
Ensuite, et compter des années 2005-2006, l'avènement du smartphone, a ouvert une phase que je qualifierais de « propagation » avec l'usage de la donnée servant à capter l'attention et vendre du « temps de cerveau disponible, selon l'expression connue. Je pense que l'on a passé le paroxysme de cette phase-là et ce pour trois raisons. La première, c'est qu'en guise de réaction à ce temps passé devant nos machines, en particulier nos smartphones, nous avons collectivement pris conscience que nous devions nous détacher de ces écrans. La deuxième raison, c'est que les Etats ont aussi décidé de passer à l'offensive.
Qu'il s'agisse de l'Union européenne et de ses réglementations DSA (Digital Services Act), DMA (Digital Markets Act), IA Act ou du Congrès des États-Unis qui n'hésitent plus à dénoncer les effets néfastes des écrans sur la santé mentale des jeunes..., on voit que de nombreuses institutions publiques ne restent pas les bras croisés. Enfin, et c'est la troisième raison, les fabricants de technologies eux-mêmes proposent désormais des applicatifs qui tendent à limiter l'usage du temps d'écran. Même la plateforme TikTok, c'est un comble..., vante son contrôle parental permettant de contrôler le temps d'écran des enfants.
La conjonction de ces trois forces me fait penser que le paroxysme de cette phase de la data monétisée couplée à cette économie de l'attention est peut-être derrière nous. Peut-être entrons-nous dans une nouvelle période qui sera influencée par l'omniprésence de l'IA. Au titre de cette « nouvelle ère », je crois que ce qui comptera le plus ce ne sera pas tant la dépendance au temps d'écran que la qualité du service rendu par ces technologies d'intelligence artificielle qui, ça c'est certain, nous assisteront dans presque toutes les tâches de nos vies.
Dans « Submersion », vous mettez en avant la notion de « l'économie de l'épuisement », idée selon laquelle que nous serions « fatigués » par cette déferlante numérique : fatigue démocratique au point de ne plus faire d'effort pour débusquer le faux du vrai, fatigue informationnelle grâce à un flot de nouvelles qui coulent en permanence sur nos écrans, fatigue pour effectuer des choix (avec l'offre numérique pléthorique, on abdique parfois au point de confier son destin à la machine ). En quoi, cette « fatigue » généralisée que vous appelez « économie de l'épuisement », fait-elle le jeu des géants du numérique ?
Ce que je nomme en effet « économie de l'épuisement » c'est le fait d'être sursollicité en permanence. Ce phénomène est le produit de l'économie numérique et de ses grands acteurs qui, plus ou moins consciemment, orchestrent cela. Au fond, c'est une sorte de cercle vicieux qui se joue entre le fait de déléguer tout ou partie de ses choix personnels à des algorithmes, ces derniers décidant alors à notre place et comme la décision prise par la machine est finalement plutôt satisfaisante, on peut avoir tendance à baisser les bras et à se laisser porter par les choix de la machine.
La théorie du "good enough", que l'on peut traduire par "suffisamment bon" ou "assez bon", éclaire sous un jour nouveau cette « délégation volontaire » : c'est l'idée que les choix proposés par les algorithmes, notamment dans le cadre des recommandations en ligne, des moteurs de recherche ou des systèmes de filtrage, exposent les utilisateurs à une gamme limitée d'options, renforçant potentiellement les biais existants et, au passage, limitant la découverte de nouvelles options. Ce résultat passable (good enough) nourrit la fatigue et crée une sorte de lassitude et de détachement. Pour lutter contre de tels travers, les plateformes numériques continuent de nous solliciter, ce qui, à son tour, produit fatigue et lassitude... la boucle est ainsi bouclée et tous les ingrédients d'un cercle pernicieux sont en place.
L'avènement de l'intelligence artificielle rebat les cartes de la productivité. En libérant du temps, la technologie nous en rend. En écho à une tribune intitulée « Qu'allons-nous faire de tout ce temps libre ? », quelle est votre analyse et prédiction sur ce surplus de temps « offert » par et grâce au numérique ?
Le constat que chacun expérimente au quotidien c'est que le numérique nous fait gagner du temps : on ne se perd plus grâce au guidage GPS immédiat, on réserve ses vacances sans avoir à passer des heures à feuilleter des catalogues ou en se rendant dans une agence de voyages, on prend rendez-vous chez le médecin en trois ou quatre clics...
Plus largement, et sur cette question du temps gagné grâce aux innovations et à la technologie, il y a toujours eu deux visions philosophiques opposées : d'un côté, il y a ceux qui pensent que ce temps dégagé doit permettre de s'élever, se cultiver, créer... Et de l'autre, ceux qui ont une conception plus pessimiste en pensant que cette ressource rare (le temps) serait gaspillée si on en devait la distribuer à foison.
Ce qui est clair c'est qu'avec l'avènement du numérique et des grandes plateformes, nous avons assisté à l'émergence d'un vrai paradoxe : ces GAFAM nous ont donné du temps, mais simultanément elles nous l'ont repris en nous incitant à consulter leurs notifications et donc les écrans. Au cours de la décennie écoulée, l'évidence c'est qu'il y a eu un très fort déséquilibre dans cet échange entre « données personnelles » et « temps ». Dit autrement, ces grandes plateformes numériques nous ont fait perdre beaucoup plus de temps (et de données personnelles) qu'elles nous en ont fait gagner.
C'est ce que montre Shoshana Zuboff dans son livre "The Age of Surveillance Capitalism" qui décrit la façon dont le modèle économique de ces grandes entreprises technologiques a créé les termes d'un échange inégal entre elles et nous. La question et l'enjeu qui se posent c'est de savoir si à l'avenir ce déséquilibre de l'économie numérique de l'attention et des données se rééquilibrera en notre faveur.
Dans la Silicon Valley aux États-Unis, là où tout a commencé, souffle actuellement un vent de « techno-optimisme » alimenté par le fait que des investisseurs, des entrepreneurs, des grandes entreprises de ce secteur... sont convaincus que l'intelligence artificielle « sauvera le monde ». Quel est votre regard sur cette version prométhéenne de la Silicon Valley ?
Cette vision messianique de l'innovation technologique californienne ne date pas d'hier. Que l'on remonte au 19e siècle, au temps des chercheurs d'or, de l'après Pearl Harbour où l'État a investi pour que se développe une industrie de pointe, mais aussi avec les communautés hippies et libertariennes..., la Californie, et en particulier la région de la Silicon Valley, a toujours été un creuset philosophique et culturel propice à la quête d'une nouvelle frontière technologique.
Ce n'est pas un hasard si les courants libertariens et transhumanistes (mouvement intellectuel et culturel qui prône l'utilisation des technologies pour améliorer les capacités humaines et transcender les limites biologiques de l'humanité) ont émergé dans ce « centre du monde » qui a vu l'invention du smartphone et de bien d'autres innovations qui façonnent aujourd'hui nos vies numériques. Depuis les fantastiques progrès et espoirs suscités par l'IA, souffle en effet sur ce territoire une vague de « techno-optimisme » qui va dans le sens de cet esprit pionnier que je décrivais, mais qui répond aussi à l'épuisement du modèle économique que je décrivais précédemment. Pour la Silicon Valley, l'IA est cette nouvelle disruption technologique, éventuellement humaniste sans oublier... financière.
Vous écrivez que nous vivons déjà dans un univers virtuel, entourés que nous sommes de présences virtuelles et de faux-semblants magnifiés par l'IA, le métaverse, la réalité augmentée... Dans ce contexte où nos vies sont « augmentées » et enjolivées, qui peut avoir encore la force et l'envie de résister aux mirages de cette réalité artificielle ?
Avec l'IA, nous sommes rentrés dans l'ère d'une double imbrication : une première imbrication qui relie de plus en plus étroitement l'Homme et la machine et une autre qui met en compétition réalité et fiction. Cette double imbrication, qu'on le veuille ou non, fait désormais partie de nos vies. Cette imbrication est vertigineuse car elle nous oblige à nous intéresser à la gestion de ce rapport entre ce qui est vrai, ce qu'on maîtrise... pour, in fine, ne pas devenir la victime de cette hallucination numérique dans laquelle on ne maîtrise plus rien. Ce qui pose question c'est notre rapport à l'imbrication.
Il n'y a pas de fatalisme et il nous revient d'apprendre à ne pas / plus subir ces mondes virtuels, ces imbrications qui nous plongent dans des fictions à partir desquelles on ne sait plus distinguer fictions et vérités à l'instar du philosophe Robert Nozick qui a proposé l'expérience de pensée appelée « La Machine à expériences ». Dans cette expérience, il demande aux individus s'ils choisiraient de se brancher à une machine qui leur fournirait des expériences de plaisir intenses et parfaites, mais totalement illusoires, ou s'ils préféraient rester dans la réalité, avec ses plaisirs et ses peines réels. L'expérience vise à explorer des questions sur le bonheur, le plaisir et la réalité. Avec le métaverse et les sujets de réalité virtuelle, nous en sommes là. Le plus difficile va être de faire la part des choses entre nos vies réelles et nos vies rêvées proposées par la machine, bref, de prendre suffisamment de distance avec cette double imbrication que j'évoquais au début de ma réponse.
Du fait de ces IA, données et algorithmes qui se trouvent au cœur des machines, nous courrons le risque d'être progressivement vidés de notre mémoire, de nos connaissances, de notre capacité d'apprendre, de nous émouvoir... qu'est-ce qui déterminera un Homme en 2050 ?
Je crois que notre principal enjeu c'est de continuer à être humain tout en côtoyant ces nouvelles technologies. Je ne sais pas comment et à quel rythme celles-ci continueront à se développer et comment elles impacteront nos vies, mais j'ai en revanche confiance dans notre capacité politique et philosophique à prendre du recul et nous adapter pour faire en sorte que ces technologies restent nos esclaves et non nos maîtres.

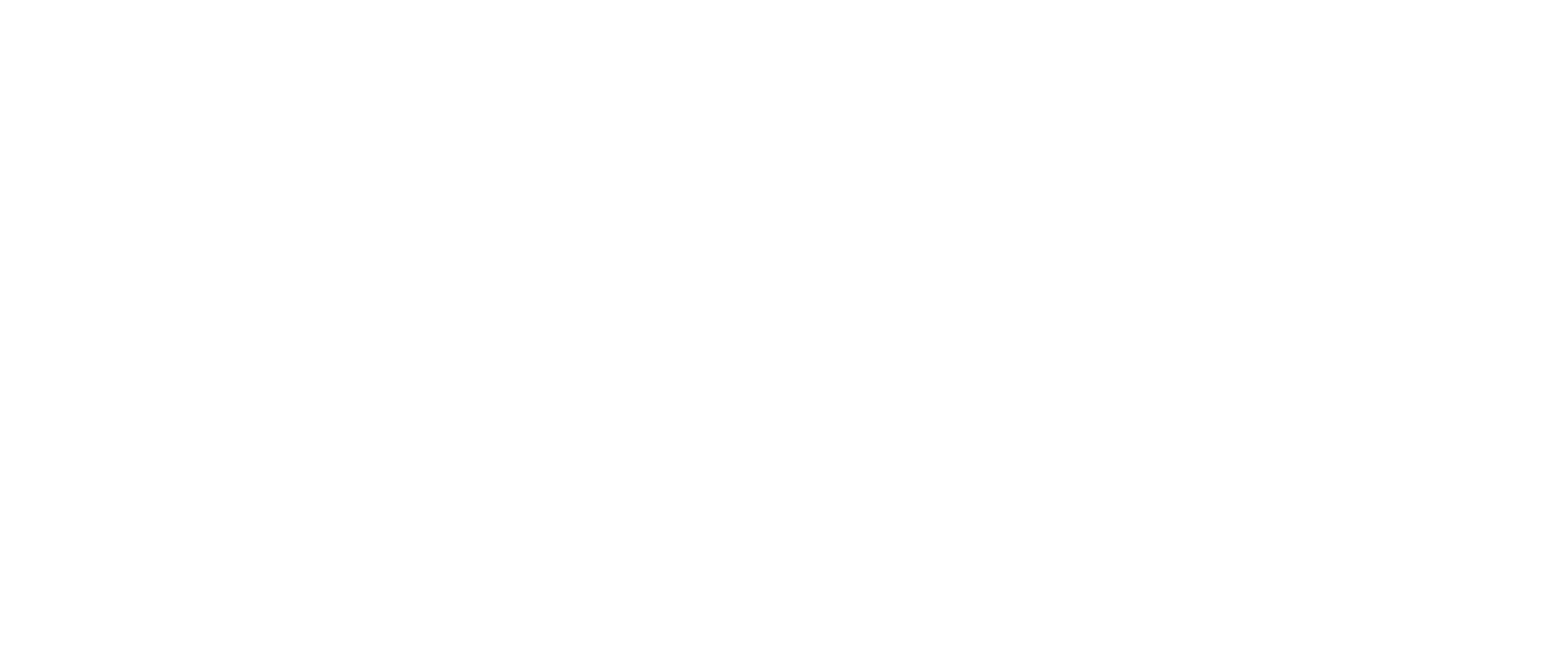

 Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français
Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

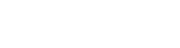
Sujets les + commentés