Affaire Tibéri, classée. Affaire Juppé, oubliée. Affaire Elf-Bidermann, relancée dans l'attente de la confrontation, jeudi prochain, du président de la SNCF, Loïk Le Floch-Prigent, avec le juge Eva Joly. Affaire Testut, jugée, Bernard Tapie ayant été condamné hier par le tribunal de Béthune à deux ans de prison avec sursis (lire également en Voir Evenementpage 35). En deux ans, une déferlante d'affaires judiciaires s'est abattue sur le monde politique et économique. Principal chef d'accusation : l'abus de biens sociaux (ABS), tant décrié depuis six mois. Avec la même qualification de mise en examen que Bernard Tapie, on retrouve des noms prestigieux comme Martin Bouygues, le président du leader français du BTP, Pierre Suard, le président déchu d'Alcatel Alsthom, ou Alain Carignon et Gérard Longuet, respectivement ex-ministres de la Communication et de l'Industrie sous le gouvernement Balladur. En revanche, ni Didier Pineau-Valencienne, le président de Schneider, ni Guy Dejouany, l'ancien président de la Compagnie Générale des Eaux, pas plus que Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, André Lévy-Lang, président du directoire de Paribas, ou encore Michel Noir, l'ex-maire de Lyon et puissant cacique de droite, n'ont été mis en examen uniquement pour abus de biens sociaux ou recel d'abus de biens sociaux. Les délits invoqués vont de l'escroquerie à la corruption active en passant par le trafic d'influence, la diffusion de fausses informations et l'abus de confiance. Preuve, comme le soutiennent bon nombre de magistrats, que les ABS ne sont que « la partie visible de l'iceberg, sous laquelle se cache une réalité bien plus subtile de la justice, de la vie des entreprises et du monde politique français ». Les politiques tétanisés par l'ABS Mais où commence et où finit l'ABS ? « A partir du moment où il y a enrichissement personnel et certainement pas si la personne mise en cause a agi dans le bien de la société », répondent d'un seul choeur chefs d'entreprise et hommes politiques. Tout le débat sur la réforme des abus de biens sociau et la jurisprudence qui s'y rattache depuis le mois de janvier, tourne autour de cette question. La difficulté est d'y répondre juridiquement sans donner l'impression que la classe politique et le monde économique s'auto-amnistient, comme ce fut le cas avec la proposition de loi Mazeaud. « Devant le tollé général que cette initiative a soulevé, plus personne n'ose s'attaquer de front au dossier, ironise un haut fonctionnaire. Jusqu'au sénateur de l'Oise, Philippe Marini, qui change d'avis tous les jours sur les ABS. Il doit pourtant rendre à Matignon le 17 juillet prochain un rapport sur le droit des sociétés. » Les tentatives du député UDF Xavier de Roux et du sénateur du même bord Jean-Jacques Hyest tardent à se concrétiser, malgré les pressions du monde patronal. Les consignes de Matignon, avant de sortir un texte, sont d'obtenir un consensus de la majorité. Or le garde des Sceaux lui-même reconnaît, en privé, que « la classe politique reste tétanisée dès que la réforme des ABS est simplement évoqué ». « La brèche s'est ouverte avec l'affaire Urba, raconte Jean-Claude Bouvier, secrétaire général du Syndicat de la magistrature. L'opinion publique a pris conscience que la frontière était perméable entre le monde politique et le monde économique. » Le juge Thierry Jean-Pierre au Mans, puis l'inspecteur Antoine Gaudino à Marseille, ont mis en lumière dès 1983 les activités de ces bureaux d'études dans le financement occulte du PS. Ils géraient les commissions versées par les entreprises désirant obtenir des marchés publics dans les fiefs socialistes. Malgré ces enquêtes, le dossier Urba a été partiellement enterré, dans un premier temps, par le jeu de la prescription et des lois d'amnistie. Mais le doute s'est infiltré chez l'homme de la rue. Et quand, en mars dernier, Henri Emmanuelli, ancien trésorier du PS, a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et deux ans de privatisation de droits civiques, il était trop tard. La machine judiciaire s'était emballée au cours d'une décennie marquée notamment par l'adoption de trois lois sur le financement des partis politiques, en 1988, 1990 et 1993 avec la fameuse loi Sapin. « Ces affaires politico-financières ont toujours existé, poursuit Jean-Claude Bouvier. Mais face à un pouvoir exécutif fort, les juges avaient peu de marge de manoeuvre. Progressivement, ce pouvoir s'est amoindri et tout a basculé au début des années 90. » Période qui coïncide exactement avec la montée en puissance de ce que l'on appelle depuis les « affaires ». L'axe justice-médias, instrument de lutte « Les ABS et la presse, souvent montrés du doigt comme responsables de cette dérive, n'ont été que des instruments utilisés par les juges pour faire émerger les dossiers délicats, explique Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à l'université Paris-Dauphine. Partant du constat qu'un axe entreprise-politique s'était constitué, les juges se sont sentis autorisés à constituer un axe justice-médias pour lutter contre la corruption. » Et la fracture s'est amplifiée. D'un côté, les industriels ne cessent de répéter « qu'ils ne peuvent plus travailler dans ce climat d'insécurité permanent ». De l'autre, les juges rétorquent « qu'ils ne peuvent pas faire autrement s'ils veulent instruire honnêtement ». Enfin les parlementaires, dont la position se résume à : « Il est urgent d'attendre pour intervenir. » Comme si plus personne n'avait la conscience tranquille. Pour Bertrand Richard, auteur du livre Dirigeant de société : un métier à risques, cette forme d'agression judiciaire à l'égard des entreprises a été provoquée par le manque de transparence du système français. « Il est très difficile pour un juge de prouver qu'un homme politique ou son parti a touché de l'argent ou des avantages en nature d'une entreprise. A plus forte raison avec le jeu des prescriptions et des amnisties, reconnaît ce conseil en recrutement de hauts dirigeants, qui refuse cette diabolisation des méthodes de la justice. En revanche, si un patron prélève une somme importante des comptes de sa société, c'est forcément en les manipulant. Par ce biais, les magistrats tentent de remonter toute la filière jusqu'au monde politique, des élus locaux aux postes suprêmes. Sans réelle préméditation ou calcul de leur part. » L'affaire Urba a commencé sur un accident de travail et celle de la Cogedim, liée au financement du Parti républicain, qui a valu au président du groupe immobilier Michel Mauer d'être incarcéré, sur une enquête de l'administration fiscale. Curieusement, les hommes politiques ont eux-mêmes ouvert le boîte de Pandore en 1993 en supprimant le privilège de juridiction au nom de l'égalité des droits des citoyens devant la loi. « Avant, il était très difficile pour un magistrat instructeur de s'attaquer à un élu, explique David Peyron, l'un des douze juges spécialisés dans les affaires financières à Paris, qui a notamment travaillé sur la Cogedim. Dès que l'enquête l'approchait de trop près, le juge était obligé de se dessaisir de la procédure et de l'envoyer à la chambre d'accusation. Et la plupart du temps, l'affaire finissait par un non-lieu. » La tactique des juges, à l'époque, consistait à mener l'enquête le plus loin possible sans passer par l'élu pour ne pas casser la dynamique de l'instruction. C'est ainsi que procédait le juge Thierry Jean-Pierre. Ces juges ayant été dessaisis de ces dossiers délicats, ces derniers ont abouti sur le bureau d'un magistrat conseiller de la chambre d'accusation de Rennes, exceptionnellement obstiné, qui n'était autre que... Renaud Van Ruymbeke. Depuis, la suppression du privilège de juridiction aidant, les juges enquêtent jusqu'au bout. Il n'empêche que les magistrats sont les premiers à admettre, du juge de base au plus haut niveau de la chancellerie, qu'il y a un vrai problème du droit pénal en France. Trois réflexions sont engagées au ministère de la Justice, qui devraient se concrétiser d'ici à la fin de l'année par trois rapports sur la procédure pénale, la procédure civile et les missions de la justice. Pour sortir de cette crise de confiance entre le judiciaire, l'économique, le politique et l'opinion publique, il faudra commencer par combler les carences juridiques des procédures civiles et commerciales. « Comment sanctionner les fautes administratives ?, s'interroge, par exemple, Jean-Claude Bouvier. Le pénal s'est transformé en une sorte d'exutoire des mises en cause des responsabilités qui ne peuvent être traitées par ailleurs. C'est flagrant dans l'affaire du sang contaminé. » Cette explosion spectaculaire des affaires judiciaires depuis cinq ans ne serait donc que le révélateur de dysfonctionnements structurels profonds de la société française, un chantier bien plus vaste que la seule réforme des ABS. Vers une indépendance des juges à l'italienne ? Une opinion relayée avec force par le procureur adjoint de la République du parquet de Paris, Jean-Claude Marin : « Les juges n'ont pas les outils juridiques nécessaires, il faut les leur donner. Et à terme, ce qui serait souhaitable, c'est un changement de statut du parquet pour qu'il ait, comme en Italie, une totale indépendance vis-à-vis du garde des Sceaux. » Conscient des remous que peuvent provoquer de tels propos dans la bouche d'un magistrat dépendant du pouvoir exécutif, il soutient cette mutation comme inéluctable : « L'Europe judiciaire se fera tôt ou tard. Elle se fera sur le modèle italien, mâtiné de droit anglo-saxon. » Car la collusion malsaine entre le monde politique et le monde économique en France ne se limite pas aux financements occultes des partis, pratiquement résolus avec les textes de lois mis en place. Un haut responsable d'un groupe malmené par « les affaires », qui s'est penché sur le sujet dans le cadre de ses fonctions dans un organe patronal, en a été le premier étonné : « L'ampleur de la corruption dans les rouages de l'économie française a été pour moi une découverte. » Bertrand Richard réfute, en partie, la thèse de certains patrons selon laquelle, sur certains marchés, dans certains pays, il est impossible de faire autrement. « Quand le système est très concurrentiel comme dans le BTP, c'est vrai qu'il est difficile de lutter contre des pratiques inavouables, surtout depuis la décentralisation, confirme-t-il. En revanche, quand les industriels sont en situation d'oligopole, comme dans le traitement des eaux ou la distribution, ils auraient pu signer un Yalta de la corruption. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas figer leurs parts de marché. » Michel-Edouard Leclerc, le fils du fondateur de la chaîne des magasins du même nom, ne s'en est jamais caché depuis des années : « Nous avons payé tout le monde, toutes tendances politiques confondues, dans l'intérêt de la société. » Pour Bertrand Richard, « les chefs d'entreprise ont beau jeu de se poser en victimes et de vouloir que l'on arrête de les attaquer. Ils n'avaient qu'à, d'eux-mêmes, mettre en place les moyens internes de contrôle qui leur permettraient aujourd'hui de mieux se défendre ». A force de vouloir diriger seuls, sans contre-pouvoirs, les patrons français se sont discrédités. Jean Peyrelevade, président du Crédit Lyonnais, n'écrivait-il pas dans le Monde du 28 février dernier : « Nous sommes seuls dans le monde développé à concentrer par la loi (4 juillet 1966, article 113) tous les pouvoirs d'administration et de direction de nos grandes sociétés dans les mains d'une seule et même personne. Les entreprises françaises seraient-elles plus difficiles à diriger que les allemandes, les anglaises... ou les américaines ? » Des conseils d'administration complaisants, des commissaires aux comptes à la fois juge et partie, des cours des comptes sans moyens... Nul ne réchappe à l'hallali. Affaire Suard : l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire Les actionnaires sont les premiers à s'en scandaliser désormais. Ceux d'Alcatel Alsthom ont violemment mis en cause les administrateurs du groupe lors de l'assemblée générale du 20 juin, choqués que les mêmes soient toujours en place alors que l'on peut s'interroger « sur leur sérieux ». De fait, pour Bertrand Richard, l'affaire Suard est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. « Pendant des mois, le conseil d'administration a défendu le dirigeant au lieu de défendre les actionnaires, tandis que le cours en Bourse était divisé par deux ! déplore-t-il. Ce n'est que contraint et forcé par la justice qu'il s'est enfin décidé à lui trouver un remplaçant et à jouer vraiment son rôle. » Cette résurrection d'un semblant de gouvernement d'entreprise a sauvé le groupe. Il était temps. Depuis deux ans, chacun s'accorde à reconnaître aujourd'hui, en interne, que le groupe n'était plus dirigé et que tout son service juridique était monopolisé pour la défense de son patron. Le corporate governance que la plupart des patrons s'empressent d'instaurer depuis quelques mois ne peut plus être qu'un effet de mode, c'est une réelle nécessité. Le rapport Viénot, commun aux deux organes patronaux, le CNPF et l'Afep, en a jeté les bases en catastrophe l'an passé. Comités exécutifs, d'audit et de rémunérations ont fleuri à la Lyonnaise et à la Générale des Eaux, chez Schneider ou Alcatel Alsthom. Il n'empêche que certains patrons donnent encore l'impression de ne pas avoir compris qu'il fallait changer les règles du jeu. D'autres s'y opposent même farouchement. « Je vois mal comment un conseil d'administration qui se réunit trois fois par an pendant deux heures, comme à la BNP, peut correctement faire son travail critique auprès du dirigeant, s'interroge Bertrand Richard. En revanche, le rythme de six fois par an, une après-midi, comme chez Saint-Gobain ou Axa, me paraît bon. » Et si, en dévoilant au grand jour les maux de l'économie et de la société française, les « affaires » avaient provoqué un électrochoc salutaire ? Sophie Seroussi
La crise de défiance
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

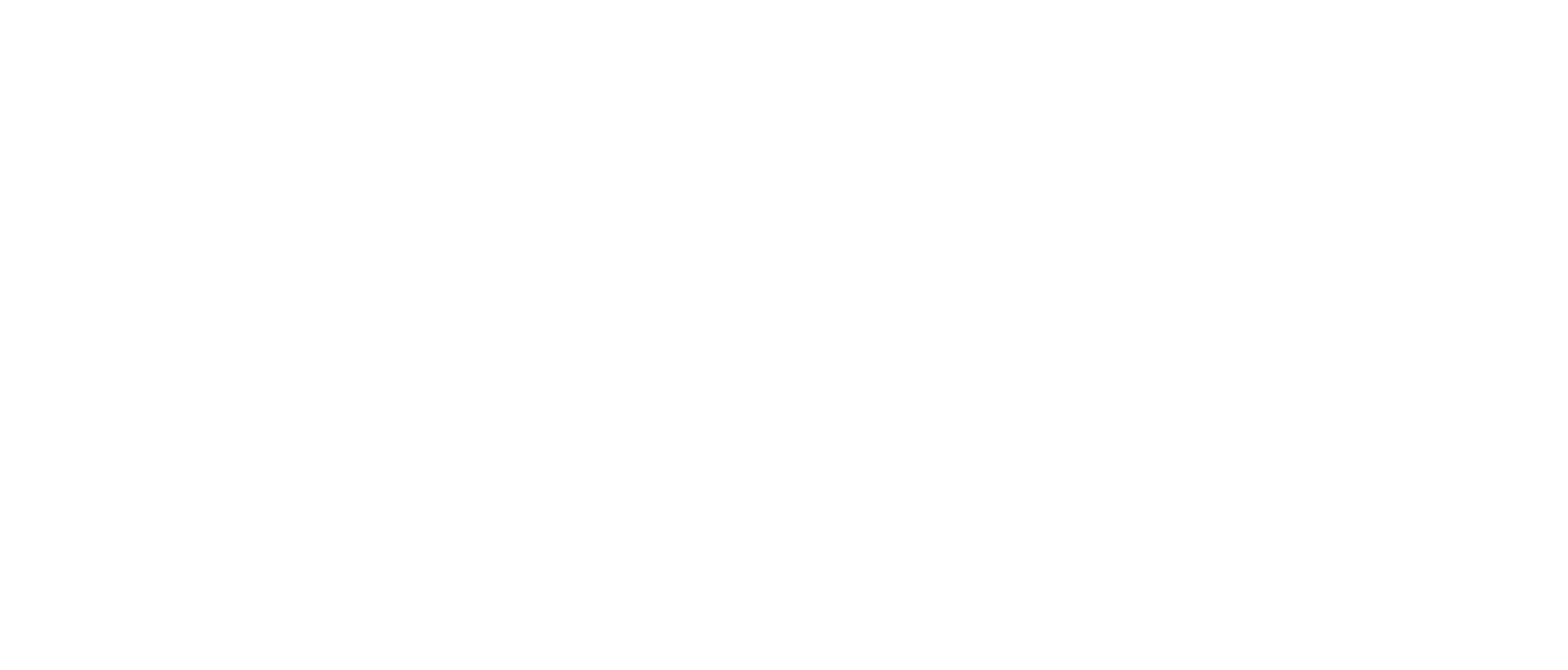


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !