
Dans l'imaginaire collectif, les doux soirs d'été corse sont tels de la cendre dorée que le soleil couchant saupoudre à la surface d'une mer d'huile... Les paillettes éblouissent les pupilles et les paillotes les papilles. Mais derrière ce décor idyllique, les restaurants de plage, tout de bois vêtus, dont les menus exhalent toutes les saveurs salines de la pêche du jour, sont beaucoup moins de strass que de stress. La concurrence y est âpre car l'activité est concentrée sur à peine quelques mois - une paillote a encore été détruite par une explosion criminelle le 13 avril dernier en Plaine orientale sur le rivage de Taglio-Isolaccio. Or, le sésame pour ouvrir son établissement éphémère est délivré longtemps en amont de la saison par les services de l'État sous la forme d'une AOT, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.
Il aura fallu une révolution culturelle pour que les paillotes historiques s'affranchissent de la coutume tenace des structures en béton sur le sable. Désormais, tout est démontable et doit être démonté à la fin de la saison. Les mesures coercitives et les sanctions pénales ont eu autant raison des mauvaises habitudes, tout comme les tempêtes submersives que le changement climatique ne manque plus de réserver aux installations qui ne sont pas mises à l'abri...
« Respecter l'équilibre entre usage commercial et accès au public »
Cette année, l'État a enregistré 317 demandes d'AOT (183 en Corse-du-Sud et 134 en Haute-Corse). 280 ont été accordées, ce qui représente un niveau de concession rarement atteint : 88 %. En 2019, par exemple, sur les quelque 400 demandes, près de la moitié avaient été refusées. Confronté aux abus, le préfet de l'époque avait voulu marquer le coup et les esprits. Après une période de relations conflictuelles, la concertation a prévalu et le climat d'apaisement est revenu grâce aussi aux organisations professionnelles en charge des filières touristiques et à la médiation de la Collectivité de Corse. « Nous avons un peu moins de demandes que l'année dernière, en raison, peut-être, d'une baisse de la fréquentation mais aussi parce que nous avons commencé à accorder des AOT pluriannuelles », explique Riyad Djaffar qui pilote la Direction de la Mer et du Littoral de Corse. Deux raisons essentielles ont motivé le rejet de la petite quarantaine de dossiers : la persistance d'installations en dur, une pratique en nette voie de disparition et la saturation des plages en demande, surtout du côté de Porto-Vecchio et de Sartène. « La finalité consiste à respecter l'équilibre entre l'usage commercial et l'accès au public », argumente Riyad Djaffar. En 2023, les AOT concernaient 104 plages et une occupation du domaine public maritime qui se déployait sur 5,5 hectares. Les nombreux contrôles effectués par les forces de l'ordre avaient débouché sur 67 contraventions et mises en demeure.
La procédure de délivrance des AOT prévoit la consultation des communes. Ces dernières ont la possibilité de demander la concession des plages et de délivrer elles-mêmes les AOT après appel d'offres. Mais sur 97 communes insulaires qui ont une façade littorale, seules quatre ont fait la démarche (deux dans le Golfe d'Ajaccio, une dans le Golfe de Sagone et Propriano) auxquelles s'ajoute désormais Calvi, en Balagne, dont la demande est en cours d'instruction. Cette forte réticence pourrait s'expliquer par la pression que souhaitent éviter les maires comme c'est déjà le cas pour eux avec les permis de construire...
Le filtre législatif du Padduc et l'érosion du littoral en prime
Les restaurateurs de plage paient une redevance pour l'obtention de l'AOT. Chaque année en Corse, le montant global de cette redevance s'élève à 2,5 millions d'euros qui vont directement dans les caisses de l'État. Cette année, cette contribution était censée représenter 4,5 % du chiffre d'affaires. Mais la conjonction de la difficile sortie de la pandémie, de la crise économique, qui grève le pouvoir d'achat, et de la flambée des titres de transports, aérien et maritime, a amené les professionnels à monter au créneau. « Nous avons demandé et obtenu sur cette question un moratoire de trois ans », se réjouit Karina Goffi. Ce n'est pas le seul sujet de satisfaction pour la présidente de l'UMIH* de Corse : « Les barèmes n'étaient pas les mêmes entre la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, ils sont aujourd'hui harmonisés. Par ailleurs, l'État a répondu favorablement à la demande d'une prolongation de la saison d'exploitation dans la limite de huit mois. » Une requête conjointement portée par César Filippi, président pour la Corse du GHR**. « Un allongement de deux mois hors montage et démontage. Les choses vont un peu mieux puisque, d'une part, les paillotiers qui respectent les règles ont la possibilité d'acquérir des AOT pour une période de trois ans (ils sont au nombre de 24 à ce jour, NDLR) et, d'autre part, la caution de 100.000 euros exigée que doivent verser les contrevenants, sera supprimée au-delà de la période probatoire de trois ans. »
En revanche, César Filippi met l'accent sur une situation d'iniquité : sur le Continent, la loi relative aux concessions des plages autorise jusqu'à 20% d'occupation du domaine public maritime. C'est beaucoup moins en Corse où s'applique aussi le Padduc*** qui hiérarchise les plages en quatre catégories, dont la première, les plages classées « naturelles », les plus sacralisées de toutes, imposent un embargo à toute activité commerciale. « La plage de Palombaggia s'étire sur sept kilomètres mais les concessions n'excèdent pas 7 % d'occupation ! Le Padduc aurait dû légalement être révisé depuis au moins trois ans », dénonce l'hôtelier de Porto-Vecchio qui prévient que son organisation ne restera pas sans agir en cas de statu quo.
Un autre phénomène, lent mais inexorable, pourrait sceller le sort des paillotes : le recul du trait de côte à cause de l'érosion. Les plages de sable de la Plaine orientale fondent inexorablement. À moyen terme, le domaine public maritime sera de moins en moins étendu.

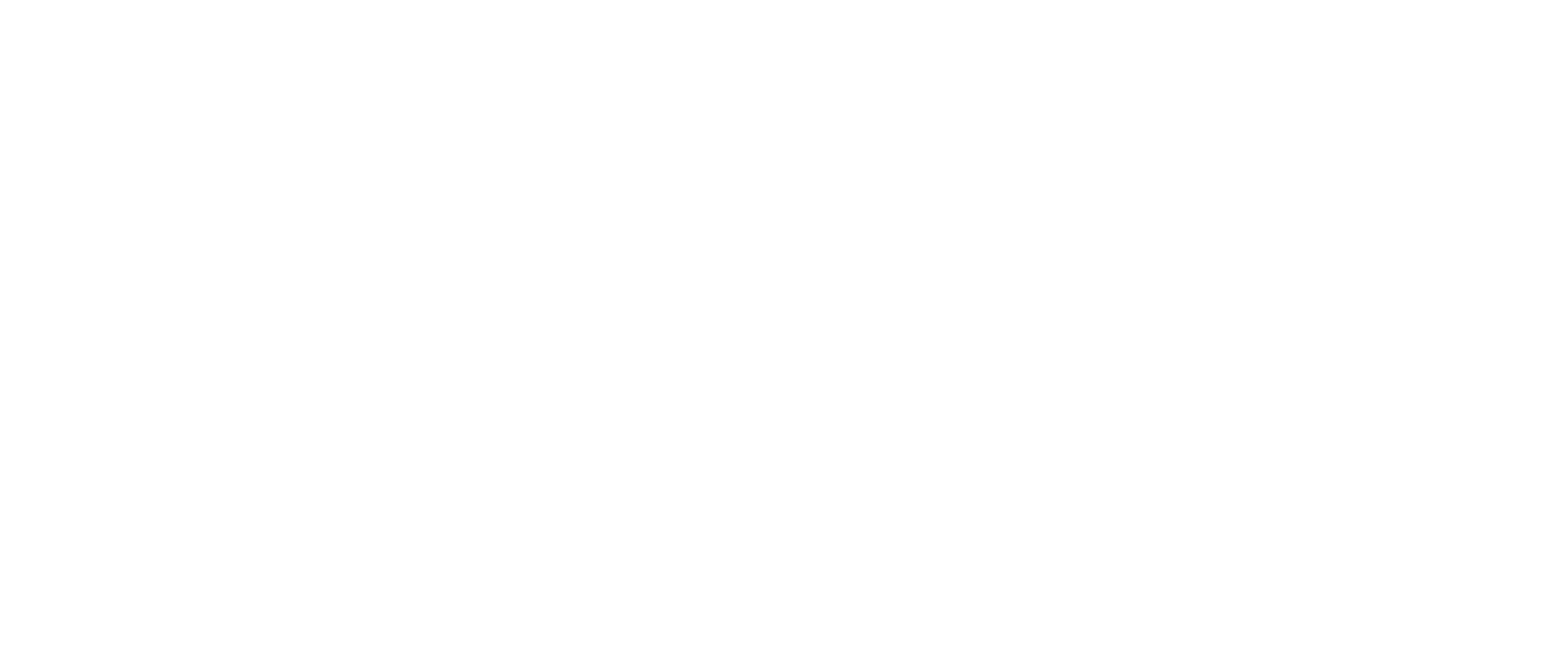
 Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers
Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers

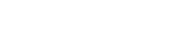
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !