
Lactalis contre l'Union nationale des éleveurs livreurs (Unell), Savencia contre Sunlait... En France, le prix du lait est régulièrement source de conflits exacerbés entre les industriels laitiers et ses fournisseurs, qui ne s'estiment pas suffisamment rémunérés. Et lorsqu'en février, pour répondre à la demande des agriculteurs de voir leurs revenus améliorés, Emmanuel Macron a promis la création de « prix plancher », c'est autour des prix du lait qu'une grande partie des débats se sont cristallisés.
Lire: Agriculture : les prix planchers d'Emmanuel Macron, une proposition qui divise le monde agricole
En même temps, d'une part à l'autre de l'Hexagone, de bonnes pratiques, saluées par la presse, fleurissent afin de garantir aux éleveurs un « prix juste ». Mais selon quels critères sont concrètement payés aujourd'hui les éleveurs français ? Et qu'est-ce qui rend leurs relations avec les laiteries si complexes ? Une multitude d'éléments entrent en jeu, qui rendent parfois les comparaisons difficiles, explique la Fédération nationale de l'industrie laitière (Fnil).
Un prix lié à des volumes et à une durée
Depuis plus d'une dizaine d'années, le prix du lait pratiqué par une laiterie vis-à-vis d'une organisation de producteurs ou d'une coopérative est déterminé dans un contrat. Il n'est pas une variable indépendante, mais corrélée à d'autres objets de la négociation : les volumes collectés, une durée d'engagement (le plus souvent de 5 ans), des conditions de production ainsi que des clauses de révision automatiques en cas d'évolutions significatives.
« Rediscuter du prix implique donc de rediscuter les autres éléments du contrat », notamment les volumes, souligne Alain Le Boulanger, délégué régional Grand Ouest de la Fédération nationale de l'industrie laitière (Fnil).
Le prix est librement fixé par les deux parties. Mais le point de départ des discussions est constitué par une formule, qui varie en fonction des types de produits laitiers fabriqués par l'industriel (lait de consommation, ultra-frais, crème, beurre, fromages, poudres) ainsi que de ses marchés (intérieur ou export) et de ses clients (grande distribution, restauration hors domicile et industriels ou grossistes).
Des « prix de base » variables
En France, les produits de grande consommation vendus en grande surface sont régis par la loi Egalim, qui impose aux premiers acheteurs de la matière première agricole de respecter leurs coûts de production. Or, pour le lait, ceux-ci varient significativement en France selon les zones géographiques, les types de production (lait conventionnel, bio, de chèvre, de brebis) et la rentabilité des fermes, rappelle le PDG de la Fnil, François-Xavier Huard. Une myriade d'indicateurs existent d'ailleurs, souligne Alain Le Boulanger : certaines petites laiteries en élaborent même de propres, en accord avec leurs organisations de producteurs, afin de se situer au plus près de la réalité du bassin de collecte.
La majorité des contrats se réfèrent toutefois à l'« indicateur du prix de revient » calculé par l'Institut technique de l'élevage, à partir d'un échantillon d'exploitations laitières. Et ce bien qu'il ne soit pas officiellement accepté par la Fnil, qui en conteste les modes de calcul, et qui ne le reconnaît donc pas comme indicateur professionnel.
Pour les produits vendus à l'étranger, soumis à la concurrence internationale, la référence utilisée est souvent le prix du lait en Allemagne. Et pour ceux vendus à la restauration hors domicile, à des industriels ou à des grossistes, c'est l'indicateur interprofessionnel « beurre-poudre », calculé par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (Cniel), qui fait référence.
Des écarts changeants
Globalement, les produits vendus dans de grandes surfaces françaises représentent 40% du lait collecté en France. Mais les pourcentages varient d'une laiterie à l'autre.
« Ainsi, dans chaque contrat entre une entreprise et une organisation de producteurs, la formule est différente », explique Alain Le Boulanger.
Selon les coûts de production et l'exposition de la laiterie aux marchés français et étrangers, les « prix de base », sur lesquels les producteurs et les industriels communiquent, connaissent donc eux-mêmes des écarts. Et ces écarts varient puisque, selon la conjoncture, le même indicateur peut être plus ou moins favorable aux éleveurs.
Une valorisation de la qualité et des conditions de production
De surcroît, ces « prix de base » ne correspondent pas au prix final payé par les industriels aux producteurs, pour plusieurs raisons. Il sont en effet établis sur un lait de référence composé de 38 grammes de matière grasse (qui sert à la fabrication de la crème et des fromages) et de 32 grammes de matière protéique (pour le lait liquide, les produits ultra-frais et les poudres). Sauf qu'en réalité, le lait livré ne correspond jamais à ce standard: sa qualité, souvent supérieure, est donc valorisée par un complément de prix.
Des malus peuvent aussi être pratiqués, reconnaît la Fnil: lorsque la teneur en matière grasse ou protéique est inférieure à ce qui est convenu, ou lorsqu'en raison de sa composition une pasteurisation complémentaire s'impose. Mais le durcissement des critères de qualité peut ainsi devenir un moyen pour contrer la hausse des prix de base. Des primes sont en outre prévues dans les contrats en fonction des conditions de production (bonnes pratiques d'élevage, pâturage, alimentation des vaches, produits AOP). Le prix final payé aux producteurs est donc le « prix TPC TQC »: « toute prime comprise et toute qualité confondue ».
Le poids contractuel des parties (producteurs et industriels) compte aussi beaucoup. A ce propos, il faut rappeler que le lait est un produit quotidien et rapidement périssable. Les éleveurs ont donc besoin qu'il soit collecté tous les jours de l'année, y compris les jours fériés et sans interruption, ce qui les met dans une situation de dépendance. Les industriels insistent pour leur part sur les coûts d'un tel engagement, qui les oblige à investir dans des outils de logistique et de transformation permettant d'éviter les gâchis. La meilleure rémunération des producteurs passe d'ailleurs souvent par une reprise en main d'une partie de la transformation.
Lire: Revenus des agriculteurs : ces éleveurs bio qui contrôlent la fixation des prix du lait
La transparence des industriels et des distributeurs en cause
Ensuite, lorsque les industriels vendent leurs produits laitiers aux distributeurs, les lois Egalim leur imposent de « sanctuariser » le prix payé pour la matière première agricole, dont le lait. Ils doivent ainsi détailler ses coûts soit produit par produit, soit par catégories, soit - via une certification d'un commissaire aux comptes - au niveau de l'entreprise. Les distributeurs accusent toutefois régulièrement les industriels de ne pas être assez transparents, notamment lorsqu'ils choisissent la troisième option.
Au coût de la matière première agricole, les industriels ajoutent leurs autres coûts de production, ainsi que leurs marges. Alors que pendant les dernières années d'inflation les critiques ont fusé contre l'accroissement des marges de l'industrie agroalimentaire, la Fnil affirme que les taux de marge nette des transformateurs de lait sont « très faibles » : de 1% en moyenne.
« Avec 11 milliards de litres de lait collectés et transformés chaque années en France, et un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros, l''industrie laitière française est une industrie de volumes. Pour comparaison, la marge nette est en moyenne de 8% dans l'automobile, 10% dans l'énergie, 15% dans le luxe, et jusqu'à 18% dans l'industrie pharmaceutique », souligne François-Xavier Huard, PDG de la Fnil.
Le prix payé par les consommateurs est bien sûr encore différent. Il est en effet fixé par les distributeurs, qui y intègrent leurs marges à eux. Ces derniers sont aussi critiqués pour leur manque de transparence.
Lire: Prix alimentaires : les marges des industriels et des distributeurs de nouveau sur la sellette
Deux exemples de négociation - Dans l'Aube, chez les éleveurs, la rentabilité est en berne. « Les opérateurs économiques comme Lactalis et Sodial ont durci leurs critères de qualité sur le lait pour contrer la hausse de leurs prix de base, dénonce Alain Boulard, président de la chambre d'agriculture du département. Cette hausse affichée ne concerne que 10 % des producteurs. Les charges n'ont pas diminué, au contraire. Résultat : la rentabilité des exploitations continue de chuter, hormis dans certaines zones d'appellation protégée, qui accompagnent convenablement leurs producteurs. » - En 2023, la coopérative Biolait dont le siège social est en Loire-Atlantique a collecté 270 millions de litres de lait auprès de plus de 1.200 exploitations implantées dans 74 départements. Ce qui représente un quart de la collecte de lait bio en France. Le lait est commercialisé auprès d'une centaine de clients de toute taille (Biocoop, Auchan, Super U, industriels...). Un volume qui s'annonce cette année en recul. « Nous envisageons une baisse de collecte, soit 250 millions de litres, et la météo du moment sur le grand Ouest confirme cette prévision », indique Philippe Marquet, producteur de lait dans la Loire et vice-président de Biolait. En 2023, le prix moyen payé au producteur était de 482 euros /1 000 litres « toutes primes comprises », en hausse de 6 % par rapport à 2022. « Nous étions une dizaine d'euros en-dessous de la moyenne des autres laiteries. » Philippe Marquet avance une explication : « la collecte "partout et pour tous" représente pour les producteurs un surcoût logistique de 30 euros à 50 euros / 1.000 litres ». Un différentiel accepté par les producteurs ? « Il est tout d'abord subi. Mais, lors de notre dernière assemblée générale, en avril, ce prix a été jugé acceptable par les adhérents. » Cette année, alors que « la conjoncture laitière est pleine d'inconnues », Biolait a fait le choix de baisser son prix d'acompte de 15 euros, à 405 euros. « Nous rajusterons en cours d'année selon les marchés », précise son vice-président.

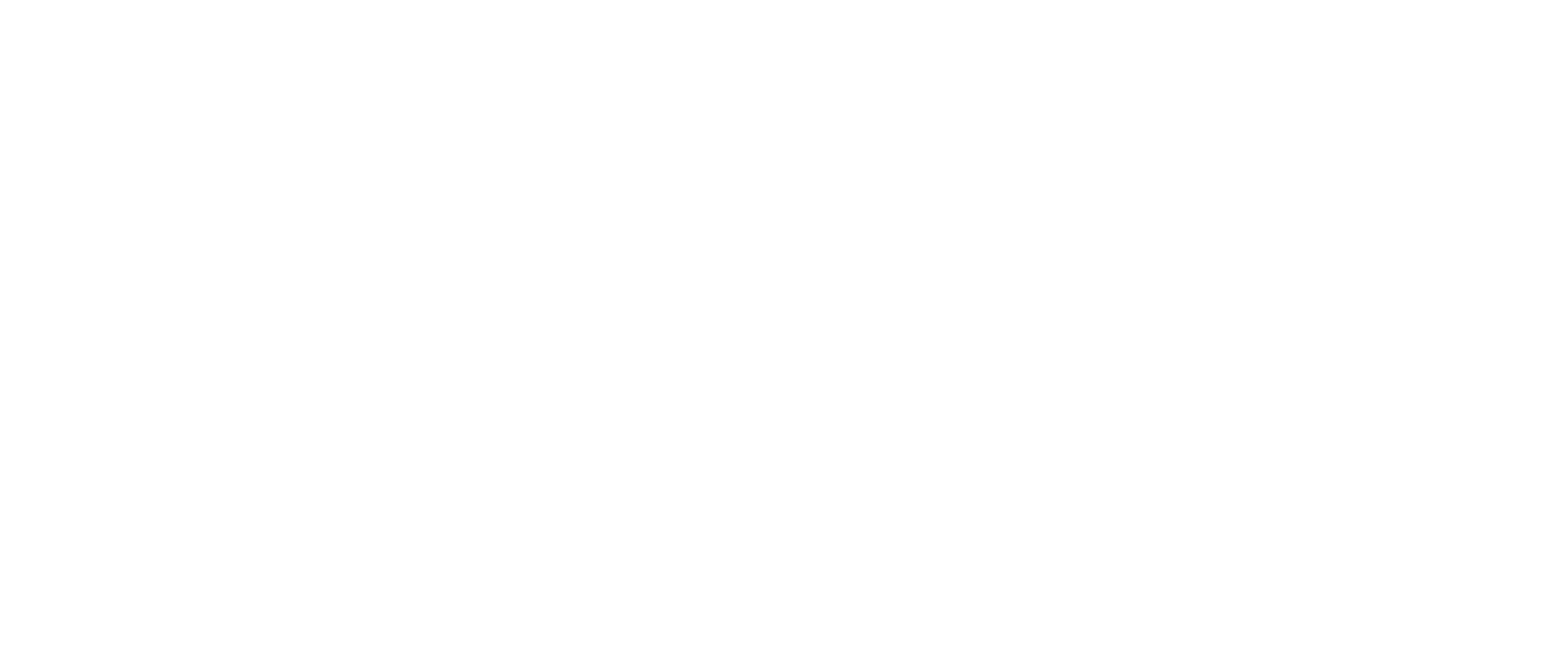
 Législatives : sur les marchés financiers, « on n’a encore rien vu »
Législatives : sur les marchés financiers, « on n’a encore rien vu »

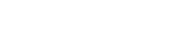
Sujets les + commentés