
Au pays de Manon des sources, la guerre de l'eau est déclarée. Elle a éclaté très exactement le 31 janvier dernier. Ce jour-là, la mort dans l'âme, les maires du Pays de Fayence décident de ne plus accorder de nouveau permis de construire. Ce chapelet de neuf villages perchés entre le nord de l'Estérel et le sud des gorges du Verdon est désormais à sec. Irrémédiablement.
En mai 2022, pour la première fois de son histoire, il a fallu ravitailler par camion-citerne le village de Seillans et son restaurant La Gloire de Mon Père. Puis les restrictions ont touché les huit autres villages. Au domaine du Château des Selves, Mylène Christine, bientôt 80 ans, « paysanne depuis des générations », a retrouvé dans les agendas de son père la trace « des sécheresses des années 1940 comme des pluies qui suivaient toujours à l'automne ». Or, compte-t-elle aujourd'hui, « en octobre et novembre, il est tombé quatre fois moins d'eau que d'habitude ; depuis 2020, il manque l'équivalent d'une année de précipitations ». Avec le changement climatique, la pluviométrie chute et les nappes phréatiques ne se reconstituent plus.
En ce début 2023, la régie des eaux a posé le problème : les 946 permis de construire en cours entraîneront l'installation de 2 273 personnes, soit une augmentation de la consommation d'eau de près de 300 000 mètres cubes par an dans un secteur, où, en vingt ans, la population a déjà doublé pour atteindre 30 000 habitants. Quant à la fréquentation touristique, elle a explosé : +30 % entre 2021 et 2022. Contrainte, la régie a sonné le tocsin : les coupures deviendront la norme l'été mais aussi l'hiver et impacteront « la sécurité incendie (bornes incendie non alimentées), la sécurité sanitaire (eau non potable) et les activités de première nécessité (métiers de bouche, santé, école, social...) ». Les neuf maires n'ont eu d'autre choix que d'arrêter de délivrer des permis de construire et de restreindre l'accès à l'eau. Ce faisant, ils se sont dressés contre les intérêts d'à peu près tout le monde. Un changement complet de paradigme dans un Var en pleine expansion. Le BTP, deuxième source d'activité du département et puissant lobby, a crié au scandale, rejoint par d'autres professions comme par des habitants, et les médias sont venus documenter ce qui semblait être une première en France. Près d'un an plus tard, le sujet crispe toujours.
Dans cette terre où Marine Le Pen est arrivée très largement en tête à la dernière présidentielle, on a commencé par ne pas y croire et cherché des coupables. Beaucoup ont tourné les yeux vers le golf de Terre Blanche et ses deux parcours verdoyants de 18 trous. Un villageois s'est plaint d'un paysan qui puisait dans une source - alors que lui-même s'en servait pour remplir sa piscine. D'autres se sont interrogés sur le jardin luxuriant d'un riche voisin, sur les dérogations des uns et des autres, sur l'eau « agricole » non surtaxée, l'absence de restriction pour les hôtels, les forages non déclarés... Et que dire des innombrables piscines, près d'une pour quatre habitants ? S'il a fallu poser des régulateurs de débit sur les compteurs de plusieurs centaines de récalcitrants, la majorité a joué le jeu en réduisant drastiquement sa consommation. N'empêche, dans ce coin cher à Pagnol, le ciel leur est tombé sur la tête et avec lui la fin du dogme de l'éternelle croissance, celle du PIB local, de la population comme du tourisme. « Cela a été un choc de se rendre compte que l'eau comme avant c'était fini », reconnaît René Ugo, maire de Seillans et président de la communauté de communes du Pays de Fayence. Même ici, sur ces terres arides et pauvres, l'accès facile à l'eau avait fait oublier l'importance de celle-ci à la population. D'ailleurs, en janvier, les élus ont d'abord parlé d'un mauvais moment à passer, le temps que « la ressource revienne ». Aujourd'hui, ils commencent à comprendre, dixit René Ugo, que « le toujours plus, c'est fini » : « Tout est remis en question, les limites sont atteintes, il faut que l'on repense entièrement notre modèle économique et social, que l'on modifie tous nos comportements. On n'est plus maîtres du jeu ; désormais, c'est la nature qui dicte. » Ce maire centriste résume en une phrase cette nouvelle ère : « La sobriété dans tous les domaines. »
Un virage complet d'autant plus délicat que les années 1970 avaient été celles du grand n'importe quoi. Partout, la nature a été artificialisée pour faire face à l'explosion des habitants comme des touristes, et les meilleures terres agricoles ont été bétonnées au profit des zones d'activités. Si l'eau est un bien commun, son usage est régi selon des critères où la productivité l'emporte généralement. Et ce territoire, bien moins peuplé que la côte, en a fait les frais. Les millions de mètres cubes du lac de barrage de Saint-Cassien, construit ici à la fin des années 1960 pour produire de l'électricité, ont été aiguillés vers les robinets de la Côte d'Azur et... le golf de Terre Blanche. Le Pays de Fayence n'a que les forages - presque toujours à sec - et l'eau de plus en plus rare des sources de la Siagnole. Pour faire face, les neuf maires ont annoncé un « plan Marshall de l'eau » en cinq points, en commençant par l'urgence et les travaux de remise à niveau d'un réseau aux nombreuses fuites. Les rendements sont passés de 63 % en 2020 à 75 %. « On peut faire encore un peu mieux », espère René Ugo. Les documents d'urbanisme ont été revus. La communauté de communes a investi dans des campagnes de sensibilisation et créé, entre autres, un salon de l'habitat et de l'écorénovation, un conseil local de l'alimentation... Car la sécurité alimentaire, déléguée à d'autres territoires, parfois très lointains, est devenue une priorité. Afin de redonner 20 hectares à l'agriculture d'ici cinq ans, Laurent Pericat, chargé de mission à la communauté de communes, utilise des leviers juridiques pour sanctuariser des terres.
Le toujours plus, c'est fini. On n'est plus maître du jeu ; désormais, c'est la nature qui dicte
René Ugo, maire de Seillans
Des forces d'inertie importantes
À la recherche de ressources en eau, les élus lorgnent le lac, réfléchissent à des forages plus profonds. Des solutions à court terme. Déjà, non loin, en période de sécheresse, le Rhône ne peut plus fournir assez d'eau potable - il lui faut d'abord refroidir les centrales nucléaires. Comment fera-t-on quand les glaciers, qui l'alimentent, auront disparu ? « Surtout, alerte Yorghos Remvikos, professeur en santé environnementale à l'université Paris-Saclay, en prélevant d'énormes quantités d'eaux souterraines, l'activité humaine pourrait contribuer à une inclination de l'axe de la Terre de 4 centimètres par an et à l'élévation du niveau des océans de plus de 6 millimètres par an. La vitesse de rotation de la Terre se trouverait impactée, sans que l'on en connaisse les conséquences à plus long terme. »
« Les changements climatiques qui s'annoncent seront potentiellement source de nouvelles tensions sur la répartition » de l'eau, pronostique le groupe régional d'experts sur le climat en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors ici, certains cherchent des chemins pour échapper aux conflits annoncés. Frédéric s'est installé sur les hauteurs de Mons, il y a tout juste trois ans. Avec d'autres paysans et quelques voisins, ce maraîcher échange matériel et « coups de main ». Il se bat pour une agriculture en lien avec la nature et pour un état d'esprit : l'entraide. C'est le même combat qui anime Bruno Bazire. À la tête d'une agence d'architecture bioclimatique, il soutient l'arrêt des permis de construire, qui nuit pourtant à ses intérêts. Voilà longtemps qu'il alerte, qu'il crée des associations - Demain Pays de Fayence est la dernière en date -, qu'il organise des manifs à vélo. « La prise de conscience n'est pas à la hauteur, dénonce-t-il. La réponse devrait être systémique, et ne pas s'attaquer juste au problème le plus urgent du moment. » Le chantier est colossal, les vents contraires puissants, les forces d'inertie importantes et, dixit le maire de Seillans, « les ressources financières ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux ». Mylène Christine, à la tête du domaine du Château des Selves qui bénéficie de l'appellation d'origine protégée côtes-de-provence, résume l'ampleur du malaise : « Au nom du progrès, du confort, on a tout climatisé, tout chauffé. Tout le monde veut plus et mieux. Mais l'industrialisation, ça réchauffe! On ne peut pas revenir en arrière. Que voulez-vous y faire ? » La guerre de l'eau ne fait que commencer. ■
Ce que dit la loi Depuis le XIXe siècle et le début de la révolution industrielle très consommatrice en eau, l'État intervient pour en réglementer les usages. Mais ce n'est qu'en 1964, avec la création des agences de l'eau, que sa gestion s'organise par bassins et que le principe de « pollueur-payeur » est introduit. En 1992, la loi sur l'eau reconnaît cette ressource comme un « patrimoine commun de la nation ». En 2016, en créant des zones dans les espaces aquatiques pour les protéger, la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ajoute une pierre à l'édifice législatif. Et pour la première fois, elle définit la notion de cours d'eau au moyen de trois critères cumulatifs : la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, l'alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l'année. C.F.

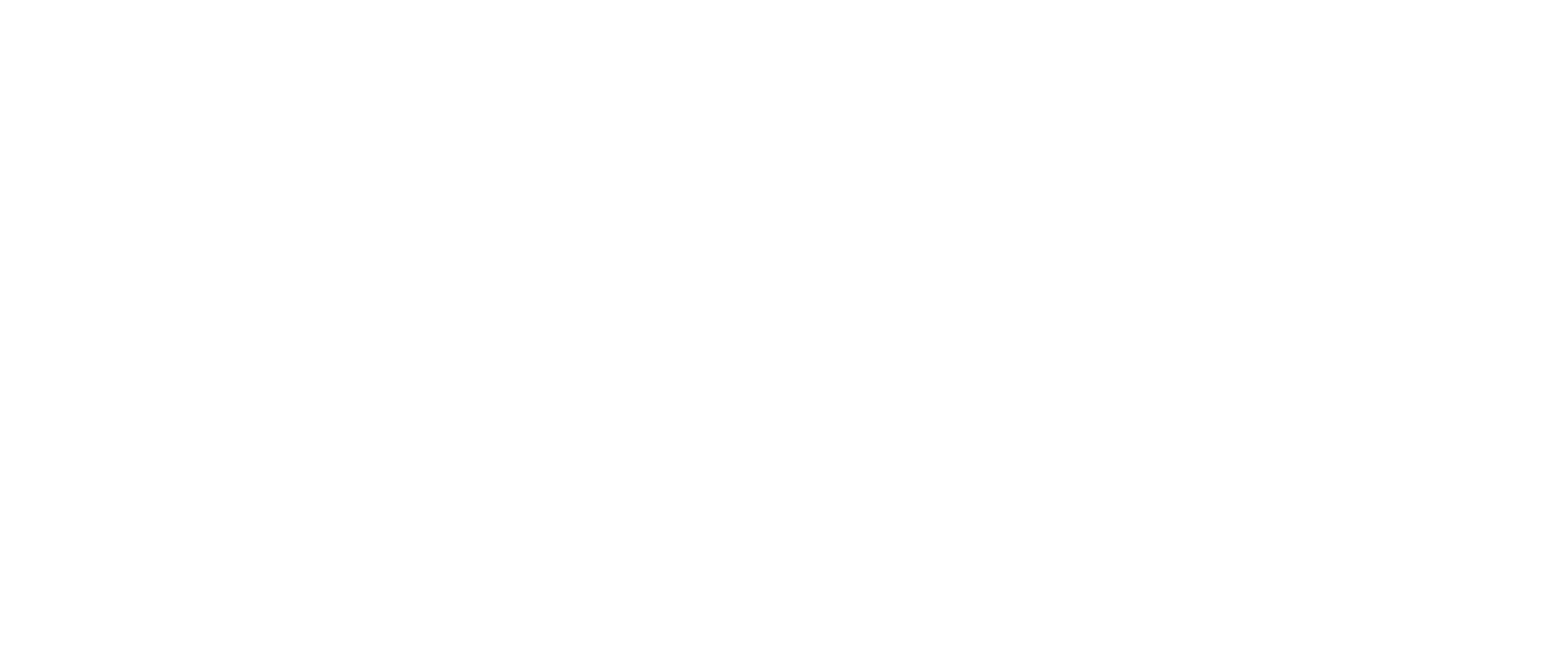
 Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français
Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

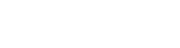
Sujets les + commentés