
Disparition de terres arables, famines, mais aussi inondations, incendies, glissements de terrain... Le changement climatique n'est pas la seule cause de ces calamités de plus en plus fréquentes. Elles sont aussi les conséquences d'un autre phénomène bien moins connu : la dégradation des sols. Pourtant, une convention-cadre des Nations unies y est consacrée depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 - dont sont aussi issues la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention sur la diversité biologique : la convention sur la lutte contre la désertification (CNULCD). Adoptée à Paris le 17 juin 1994, elle aura 30 ans ce lundi.
« Réchauffement climatique, dégradation des terres et perte de biodiversité sont des phénomènes intrinsèquement liés et qui ont tendance à s'amplifier mutuellement », explique le Comité scientifique français de la désertification (CSFD), créé en 1997 par les ministères de l'Écologie, des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche afin de contribuer aux réflexions sur le sujet. « Mais, comme pour le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, la principale cause de la dégradation des terres, ce sont des activités humaines mal adaptées à leur contexte », observe Jean-Luc Chotte, président du CSFD. Les mauvaises pratiques agricoles et l'utilisation de produits phytosanitaires, qui appauvrissent les sols et affectent leur capacité à alimenter les nappes phréatiques, figurent en tête de ces activités nuisibles. L'exploitation minière, le surpâturage et la déforestation en font aussi partie.
Le défi environnemental qui en découle est énorme. « La dégradation des sols concerne déjà 40 % de la surface terrestre mondiale », note Jean-Luc Chotte. « On parle de "désertification" lorsqu'elle frappe spécifiquement des zones arides, semi-arides et subhumides sèches, qui font l'objet d'une attention particulière », précise-t-il. Mais elle ne concerne pas seulement les pays du Sud.
La dégradation des sols, en effet, se développe très rapidement : « Chaque seconde, l'équivalent de quatre terrains de football de terre saine se dégrade, soit 100 millions d'hectares par an », s'alarme le CSFD. Avec l'augmentation des températures et le dérèglement du cycle de l'eau à un niveau planétaire, les zones où la dégradation des terres devient désertification, définies en fonction de la faiblesse des pluies et de l'importance de l'évaporation de l'eau, s'étendent. Et la lutte contre la désertification patine : le projet de la Grande Muraille verte en Afrique subsaharienne, qui prévoyait la restauration de 100 millions d'hectares de terres en 2030, n'en est qu'à une trentaine.
130 pays engagés
Pourtant, l'humanité dépend des sols pour 95 % de son alimentation, s'alarme le CSFD. Et le retour sur investissement serait significatif : chaque euro consacré à la restauration des terres pourrait rapporter jusqu'à 30 euros, pointe le même comité.
La CNULCD ne contraint toutefois pas ses 197 pays membres à se fixer des objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres : elle les invite seulement à le faire de manière volontaire. Cent trente d'entre eux se sont néanmoins déjà engagés à atteindre cette neutralité avant 2030. Les moyens vont de la prévention à la restauration des terres désertifiées, à travers des techniques nouvelles, comme la surveillance par satellite, ou traditionnelles, telles que l'édification de terrasses sur les collines. La convention a aussi pour objectif de mieux coordonner les programmes de financement, d'assurer leur efficacité ainsi que la participation locale dans la prise de décisions. Elle promeut la coopération internationale en matière de recherche et d'observation scientifiques.
Tous les deux ans, les membres de la CNULCD se réunissent en une Conférence des parties (COP), dont la dernière (COP15) s'est tenue en Côte d'Ivoire en 2022. La prochaine (COP16) est prévue en Arabie saoudite en décembre 2024, juste après la COP16 sur la biodiversité en octobre et la COP29 sur le climat en novembre. De ce rendez-vous, Alain-Richard Donwahi, président de la COP15 contre la désertification, espère au moins l'obtention d'un accord « sur l'urgence de réaliser un bilan commun ». Aujourd'hui, aucun des divers outils et méthodes visant à évaluer la santé des sols n'est en effet reconnu comme référence commune par l'ensemble des pays. Or « comment se fixer une ambition partagée sans un diagnostic harmonisé ? » pointe-t-il.
L'ancien ministre des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire espère aussi que cette succession de COP permettra une meilleure synergie dans la lutte contre les divers défis environnementaux. Pour lui, le principal moyen de lutte contre la désertification reste toutefois la sensibilisation. « Elle est essentielle pour mobiliser les pouvoirs publics, qui doivent mieux intégrer cet enjeu dans leurs politiques de développement, et les acteurs privés, qui doivent participer au financement, estime Alain-Richard Donwahi. Mais elle doit surtout alerter les communautés locales : ce sont elles qui, en modifiant leurs pratiques, joueront le premier rôle dans la lutte contre la désertification. »
169 pays se sont déclarés affectés par la désertification dans le cadre de la CNULCD 10% du PIB mondial est perdu en raison de la désertification, selon la présidence de la COP15 50 millions de personnes pourraient être déplacées au cours des dix prochaines années en raison de la désertificationEn chiffres

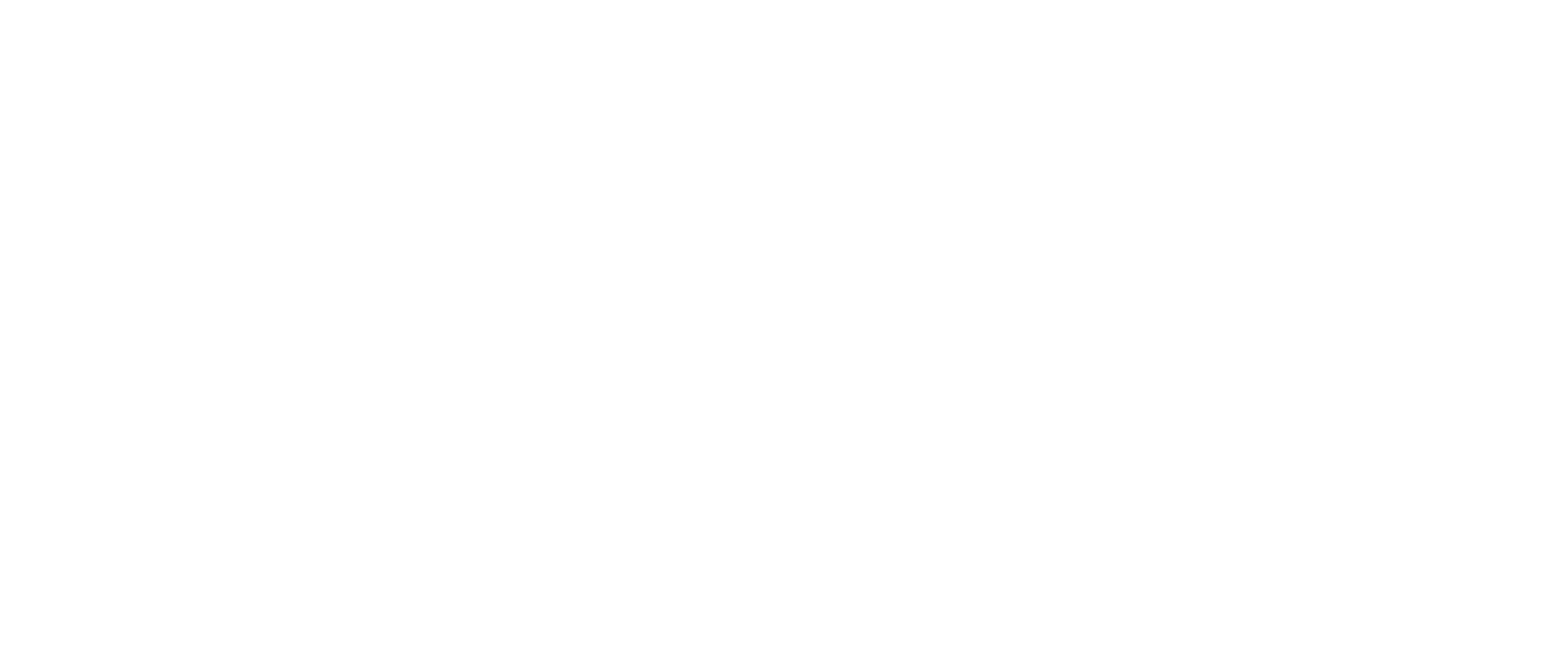
 Législatives : sur les marchés financiers, « on n’a encore rien vu »
Législatives : sur les marchés financiers, « on n’a encore rien vu »

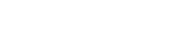
Sujets les + commentés